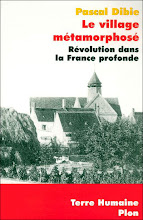mardi 23 mars 2010
mardi 5 janvier 2010
ETHNOLOGIE DE LA POCHE II
Pour revenir à des choses concrètes domestiques et quotidiennes, je pense à l’utilisation de la Carte Bleue. Ce petit bout de plastique empucé, objet simplissime en apparence, duquel émane de moins en moins le sentiment de manipuler de l’argent qui, une fois tiré de la poche intérieur de son veston ou de son sac et de son étui, est plus l’expression d’un pouvoir d’achat immédiat et virtuel qu’autre chose. Il s’agit bien en effet d’un pouvoir d’achat triangulaire qui profite autant à la banque qui l’émet, qu’aux commerces qui l’acceptent et au consommateur qui l’utilise, quoi que ce dernier soit par son biais soumis à une pression croissante sur les « rentrées » pour assurer le remboursement des avances-prêts qui lui sont automatiquement (et sur un certain volume) consenties. Ce que je cherche à montrer par cet exemple c’est qu’on est en train de se mettre en place un nouveau rapport à l’argent non-argentée où la consommation apparaît comme seule fin et que ce nouveau rapport nous fait de facto rentrer dans une discipline temporelle nouvelle. Ce qui est en jeu dans notre univers de consommation industrielle tardive est la transformation même de l’idée d’avenir en marchandise comme le relève Appudarai : « Tout ceci s’appuie sur une tension particulière entre imagination et nostalgie qui incarne et nourrit l’incertitude des consommateurs quant aux biens, à l’argent et à la relation entre travail et loisir. » Ce n’est pas tant, comme l’écrivait Jean Baudrillard, que la consommation joue un rôle central dans les sociétés où la production jouait autrefois ce rôle, que la consommation qui a pris un autre sens : « elle est devenue le travail civilisateur de la société post-industrielle »
A ce stade un détour par l’étymologie concernant nos aventures consuméristes n’est peut être pas inutile pour comprendre d’où nous venons et en partie pourquoi nous le faisons. Consommer qui fut d’abord consummer (1120) pour devenir consommer (1570) de con, avec, et summa, somme : « faire le total de… », signifiait dans la langue classique « accomplir, mener à son terme, à son achèvement ».Une confusion décisive s’opéra entre consumere, consumer, et consummare dont le synonyme perdere , perdre, destuere, détruire, furent souvent liés, notamment dans le contexte de la parousie chrétienne où l’achèvement des temps coïncide précisément avec la fin du monde. Quant à la Consommation d’abord consummacium (1120) emprunté au latin consumatio, « accomplissement, achèvement, perfection » en rapport chez les auteurs chrétiens avec l’« achèvement des temps ,la fin du monde » ;
sous l’influence du verbe , il a commencé a désigner « l’usage que l’on fait d’une chose pour satisfaire ses besoins »au XVI éme siècle et s’est spécialisé en économie dés le XVII éme. Mais ce n’est qu’en 1945 que sont apparus dans le contexte de l’économie capitaliste les syntagmes de « société de consommation »et « biens de consommation ». Le succès de cet emploi dans le sens économique , articulé avec celui de la production de « biens de grande consommation » fit que le mot se spécialisa et qu’apparu dans la première moitié du XX ème siècle des expressions comme « Sous-consommation », 1926, « Sur-consommation », 1955,ou « Auto-consommation » en 1955. Le mot de Consommateur, trice (1525) suivi la même évolution, passant du langage théologique courant au langage économique (1745) en commençant par désigner des habitudes nouvelles comme le nouveau « consommateur de café ». Aujourd’hui avec le développement de la revendication pour la défense des intérêts du consommateur sont apparus consumériste et consumerisme (1972).Enfin, La consommatique (1975) apparu pour désigner l’ensemble des recherches ayant trait à la consommation.
Dire des sociétés industrielles contemporaines qu’elles sont des sociétés de consommateurs n’est en fait pas suffisant, la consommation actuelle transforme l’expérience du temps d’une façon qui la distingue fondamentalement de ses formes précédentes du XVIIe au XIX e. Pour un grand nombre de consommateurs contemporains la consommation est en effet devenue non plus l’horizon du gain mais bien son moteur. Le temps n’est plus seulement présent dans la production, il l’est aussi dans la consommation qui est devenue le moteur essentiel de la société industrielle au point que l’on peut désormais parler de la consommation comme d’une discipline temporelle. Au point aussi comme l’écrit écrit Arjun Appadurai que « la consommation est la pratique quotidienne par laquelle la nostalgie et l’imagination sont tirées l’une et l’autre dans le monde de la marchandise.»Il fait aussi remarquer qu’il s’agit d’une sorte de nostalgie sans mémoire c'est-à-dire d’une nostalgie inventée, construite, imposée, voir inculquée qui est devenue centrale dans le marketing de masse. Ce qui nous importe ici c’est de retenir que la consommation est à présent la pratique sociale qui amène les individus a travailler de plus en plus leur imagination de consommateur. Cela se traduit par un réel travail de l’imagination mais essentiellement inscrit dans le temps-marchandise. Sans nous en rendre compte nous avons subit une véritable « révolution de la consommation » au point qu’elle est devenue une forme sérieuse de travail.
D’après les anthropologues le cœur de ce travail est la discipline sociale de l’imagination qui consiste à lier l’imagination au désir de nouvelles marchandises. On surf désormais sur les flux temporels ouverts du crédit à la consommation et de l’achat « dans un paysage où la nostalgie a divorcé de la mémoire » et qui implique effectivement de nouvelles formes de travail : gérer ses dettes et ses découverts,autrement dit apprendre à gérer au mieux des finances domestiques de plus en plus complexes ce qui, en contrepartie, implique d’ acquérir une connaissance des complexités toujours plus grande de la gestion de l’argent et en même temps déchiffrer les messages toujours changeants de la mode. A l’origine de ce travail, il y a quelque chose de nouveau et de contradictoire par rapport à l’étymologie même du mot travail qui vient, je le rappelle, du bas latin trepalium , instrument de torture, du latin classique tripalis, « à trois pieux »et qui du point de vue technique signifiait le dispositif servant à immobiliser les bœufs ou les chevaux pour les ferrer. Quand je pare de contradiction c’est qu’il s’agit d’accoler au mot travail celui du plaisir. Le plaisir qui, étymologiquement, a quelque chose a voir avec l’apaisement, apparaîtrait comme un principe organisateur de la consommation moderne. Il s’agit d’un plaisir évidemment construit, basé sur l’éphémère et imposé aux sujets agissant comme des consommateurs qui se trouve « dans la tension entre nostalgie (revoilà le temps) et imagination où le présent est représenté comme s’il était déjà du passé ! » Ce plaisir implique une nouvelle stratégie de la pensée domestique et consiste plutôt à produire des conditions conscientes dans lesquelles l’achat désiré peut intervenir. C’est comme cela que désormais nous sommes tous devenu des maîtresses de maison travaillant chaque jour à pratiquer les disciplines de l’achat dans un paysage où les structures temporelles sont devenues polyrythmiques. Non seulement désormais il nous faut subir mais aussi connaître les multiples rythmes du corps, des produits, des modes, des cadeaux, des styles et des taux d’intérêt, mais en plus il nous faut apprendre à intégrer ces rythmes pour les faire cohabiter .Cela demande de l’imagination, beaucoup d’imagination ce qui est un travail presque à plein temps! Ceci nous ramène également à Durkheim et à Mauss à propos de la conscience collective et du phénomène social total a la nouveauté prêt que le travail de la consommation qui s’y ajoute est un véritable travail qui est autant symbolique que social, surtout quand s’y ajoute cette notion jusque là impensable dans nos civilisations de l’éphémère.
« La consommation créée du temps,remarque Arjun Appadurai, mais la consommation moderne cherche à remplacer l’esthétique de la durée par celle de l’éphémère. Dans cette perspective l’esthétique de l’éphémère devient la contrepartie civilisante de l’accumulation flexible et le travail de l’imagination consiste à lier l’aspect éphémère des marchandises au plaisir des sens. » En 2006 je notais dans mon étude sur la rurbanité à travers la vie d’un petit village de l’Yonne que dans nos sociétés post-industrielles qui se définissent comme sociétés rationnelles la mutation post-moderne se caractérise justement par la production devenue innombrable de millions d’objets semblables et à durée très limitée. Est-ce que cette valorisation de l’éphémère ne serait pas justement la clé de la consommation moderne ? Ce qui est nouveau en effet ce n’est pas tant une nouvelle mise en esclavage (la consommation au niveau domestique a toujours impliqué une sorte si non d’esclavage au moins de dressage mental ), que « le lien systématique et généralisé de facteurs en un ensemble de pratiques qui impliquent une relation radicalement nouvelle entre vouloir, se souvenir, être et acheter. »
Voir : Arjun Appadurai, « Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation », Payot, 2001. le titre original « Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization » University of Minnesota, 2001, nous paraît beaucoup plus approprié au contenu réel de cet ouvrage qui paraît très important quant aux nouveaux regards anthropologiques portés sur nos sociétés. »
Pour revenir à des choses concrètes domestiques et quotidiennes, je pense à l’utilisation de la Carte Bleue. Ce petit bout de plastique empucé, objet simplissime en apparence, duquel émane de moins en moins le sentiment de manipuler de l’argent qui, une fois tiré de la poche intérieur de son veston ou de son sac et de son étui, est plus l’expression d’un pouvoir d’achat immédiat et virtuel qu’autre chose. Il s’agit bien en effet d’un pouvoir d’achat triangulaire qui profite autant à la banque qui l’émet, qu’aux commerces qui l’acceptent et au consommateur qui l’utilise, quoi que ce dernier soit par son biais soumis à une pression croissante sur les « rentrées » pour assurer le remboursement des avances-prêts qui lui sont automatiquement (et sur un certain volume) consenties. Ce que je cherche à montrer par cet exemple c’est qu’on est en train de se mettre en place un nouveau rapport à l’argent non-argentée où la consommation apparaît comme seule fin et que ce nouveau rapport nous fait de facto rentrer dans une discipline temporelle nouvelle. Ce qui est en jeu dans notre univers de consommation industrielle tardive est la transformation même de l’idée d’avenir en marchandise comme le relève Appudarai : « Tout ceci s’appuie sur une tension particulière entre imagination et nostalgie qui incarne et nourrit l’incertitude des consommateurs quant aux biens, à l’argent et à la relation entre travail et loisir. » Ce n’est pas tant, comme l’écrivait Jean Baudrillard, que la consommation joue un rôle central dans les sociétés où la production jouait autrefois ce rôle, que la consommation qui a pris un autre sens : « elle est devenue le travail civilisateur de la société post-industrielle »
A ce stade un détour par l’étymologie concernant nos aventures consuméristes n’est peut être pas inutile pour comprendre d’où nous venons et en partie pourquoi nous le faisons. Consommer qui fut d’abord consummer (1120) pour devenir consommer (1570) de con, avec, et summa, somme : « faire le total de… », signifiait dans la langue classique « accomplir, mener à son terme, à son achèvement ».Une confusion décisive s’opéra entre consumere, consumer, et consummare dont le synonyme perdere , perdre, destuere, détruire, furent souvent liés, notamment dans le contexte de la parousie chrétienne où l’achèvement des temps coïncide précisément avec la fin du monde. Quant à la Consommation d’abord consummacium (1120) emprunté au latin consumatio, « accomplissement, achèvement, perfection » en rapport chez les auteurs chrétiens avec l’« achèvement des temps ,la fin du monde » ;
sous l’influence du verbe , il a commencé a désigner « l’usage que l’on fait d’une chose pour satisfaire ses besoins »au XVI éme siècle et s’est spécialisé en économie dés le XVII éme. Mais ce n’est qu’en 1945 que sont apparus dans le contexte de l’économie capitaliste les syntagmes de « société de consommation »et « biens de consommation ». Le succès de cet emploi dans le sens économique , articulé avec celui de la production de « biens de grande consommation » fit que le mot se spécialisa et qu’apparu dans la première moitié du XX ème siècle des expressions comme « Sous-consommation », 1926, « Sur-consommation », 1955,ou « Auto-consommation » en 1955. Le mot de Consommateur, trice (1525) suivi la même évolution, passant du langage théologique courant au langage économique (1745) en commençant par désigner des habitudes nouvelles comme le nouveau « consommateur de café ». Aujourd’hui avec le développement de la revendication pour la défense des intérêts du consommateur sont apparus consumériste et consumerisme (1972).Enfin, La consommatique (1975) apparu pour désigner l’ensemble des recherches ayant trait à la consommation.
Dire des sociétés industrielles contemporaines qu’elles sont des sociétés de consommateurs n’est en fait pas suffisant, la consommation actuelle transforme l’expérience du temps d’une façon qui la distingue fondamentalement de ses formes précédentes du XVIIe au XIX e. Pour un grand nombre de consommateurs contemporains la consommation est en effet devenue non plus l’horizon du gain mais bien son moteur. Le temps n’est plus seulement présent dans la production, il l’est aussi dans la consommation qui est devenue le moteur essentiel de la société industrielle au point que l’on peut désormais parler de la consommation comme d’une discipline temporelle. Au point aussi comme l’écrit écrit Arjun Appadurai que « la consommation est la pratique quotidienne par laquelle la nostalgie et l’imagination sont tirées l’une et l’autre dans le monde de la marchandise.»Il fait aussi remarquer qu’il s’agit d’une sorte de nostalgie sans mémoire c'est-à-dire d’une nostalgie inventée, construite, imposée, voir inculquée qui est devenue centrale dans le marketing de masse. Ce qui nous importe ici c’est de retenir que la consommation est à présent la pratique sociale qui amène les individus a travailler de plus en plus leur imagination de consommateur. Cela se traduit par un réel travail de l’imagination mais essentiellement inscrit dans le temps-marchandise. Sans nous en rendre compte nous avons subit une véritable « révolution de la consommation » au point qu’elle est devenue une forme sérieuse de travail.
D’après les anthropologues le cœur de ce travail est la discipline sociale de l’imagination qui consiste à lier l’imagination au désir de nouvelles marchandises. On surf désormais sur les flux temporels ouverts du crédit à la consommation et de l’achat « dans un paysage où la nostalgie a divorcé de la mémoire » et qui implique effectivement de nouvelles formes de travail : gérer ses dettes et ses découverts,autrement dit apprendre à gérer au mieux des finances domestiques de plus en plus complexes ce qui, en contrepartie, implique d’ acquérir une connaissance des complexités toujours plus grande de la gestion de l’argent et en même temps déchiffrer les messages toujours changeants de la mode. A l’origine de ce travail, il y a quelque chose de nouveau et de contradictoire par rapport à l’étymologie même du mot travail qui vient, je le rappelle, du bas latin trepalium , instrument de torture, du latin classique tripalis, « à trois pieux »et qui du point de vue technique signifiait le dispositif servant à immobiliser les bœufs ou les chevaux pour les ferrer. Quand je pare de contradiction c’est qu’il s’agit d’accoler au mot travail celui du plaisir. Le plaisir qui, étymologiquement, a quelque chose a voir avec l’apaisement, apparaîtrait comme un principe organisateur de la consommation moderne. Il s’agit d’un plaisir évidemment construit, basé sur l’éphémère et imposé aux sujets agissant comme des consommateurs qui se trouve « dans la tension entre nostalgie (revoilà le temps) et imagination où le présent est représenté comme s’il était déjà du passé ! » Ce plaisir implique une nouvelle stratégie de la pensée domestique et consiste plutôt à produire des conditions conscientes dans lesquelles l’achat désiré peut intervenir. C’est comme cela que désormais nous sommes tous devenu des maîtresses de maison travaillant chaque jour à pratiquer les disciplines de l’achat dans un paysage où les structures temporelles sont devenues polyrythmiques. Non seulement désormais il nous faut subir mais aussi connaître les multiples rythmes du corps, des produits, des modes, des cadeaux, des styles et des taux d’intérêt, mais en plus il nous faut apprendre à intégrer ces rythmes pour les faire cohabiter .Cela demande de l’imagination, beaucoup d’imagination ce qui est un travail presque à plein temps! Ceci nous ramène également à Durkheim et à Mauss à propos de la conscience collective et du phénomène social total a la nouveauté prêt que le travail de la consommation qui s’y ajoute est un véritable travail qui est autant symbolique que social, surtout quand s’y ajoute cette notion jusque là impensable dans nos civilisations de l’éphémère.
« La consommation créée du temps,remarque Arjun Appadurai, mais la consommation moderne cherche à remplacer l’esthétique de la durée par celle de l’éphémère. Dans cette perspective l’esthétique de l’éphémère devient la contrepartie civilisante de l’accumulation flexible et le travail de l’imagination consiste à lier l’aspect éphémère des marchandises au plaisir des sens. » En 2006 je notais dans mon étude sur la rurbanité à travers la vie d’un petit village de l’Yonne que dans nos sociétés post-industrielles qui se définissent comme sociétés rationnelles la mutation post-moderne se caractérise justement par la production devenue innombrable de millions d’objets semblables et à durée très limitée. Est-ce que cette valorisation de l’éphémère ne serait pas justement la clé de la consommation moderne ? Ce qui est nouveau en effet ce n’est pas tant une nouvelle mise en esclavage (la consommation au niveau domestique a toujours impliqué une sorte si non d’esclavage au moins de dressage mental ), que « le lien systématique et généralisé de facteurs en un ensemble de pratiques qui impliquent une relation radicalement nouvelle entre vouloir, se souvenir, être et acheter. »
Voir : Arjun Appadurai, « Après le colonialisme, Les conséquences culturelles de la globalisation », Payot, 2001. le titre original « Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization » University of Minnesota, 2001, nous paraît beaucoup plus approprié au contenu réel de cet ouvrage qui paraît très important quant aux nouveaux regards anthropologiques portés sur nos sociétés. »
mercredi 9 décembre 2009
Esquisse d’une ethnologie de poche et de la crise (I)
 Ou comment aborder la question de l’argent et de la crise quand on n’est ni financier, ni économiste, et de surcroît lorsque l’on est ethnologue ?
Ou comment aborder la question de l’argent et de la crise quand on n’est ni financier, ni économiste, et de surcroît lorsque l’on est ethnologue ?J’ai trouvé une réponse en me lançant dans une tentative d’esquisse d’une ethnologie de la poche, une sorte de micro-ethnologie jusqu’ici rarement tentée. La poche ou plutôt les poches, ces replis et aménagements spéciaux définitifs dans nos vêtements, sont reliés à une topographie et une hiérarchisation toutes particulières.
Pour inscrire ce terrain dans la société occidentale, je prendrai le cas d’un complet classique dit « trois pièces ». Cela va des poches arrières ou postérieures - dites aussi poches revolver - en passant par des poches profondes latérales pour le pantalon, aux « poches intérieures » du veston, réservées au portefeuille et autres documents, puis aux poches extérieures à revers du veston ainsi qu’aux goussets, les petites poches du gilet où l’on glisse sa montre d’un côté et de la petite monnaie vite dégainée de l’autre (comme on peut encore le voir dans des films). Je n’oserais dire que « tout est dans la poche », mais pour ce qui est de l’homme en activité et de l’argent c’est là qu’il y est le plus souvent remisé. Qui n’a pas un jour sinon payé de sa poche, au moins été de sa poche alors qu’elles étaient pleines, pendant qu’un autre s’en mettait plein les poches et que vous assistiez à la fonte de votre argent de poche, très loin de croire que l’affaire était dans la poche, sachant que vous alliez vous retrouver les poches vides ? Voila un sentiment désagréable mais moins traumatisant pourtant que de s’être fait faire les poches par un individu menaçant qui cherchait lui, par vase plusou moins communicant, à se remplir les poches de votre liquide… Après ce genre d’aventure, on a parfois un peu de mal à remettre la main à la poche tant on y a été de sa poche alors que l’autre exulte « c’est dans la poche ! ». Voila en tout cas une situation où, content de n’être pas complètement dépouillé, on ravale sa fierté dans sa poche comme dit l’expression.
Je voudrais revenir plus précisément à la raison qui m’a orienté naturellement vers le terrain mouvant de la poche : l’argent et les crise qui y ont trait, plus précisément la monnaie qu’on y enfourne, qui devient de l’argent dans la poche sans pour autant être obligatoirement de l’argent de poche. Pour être plus précis ce n’est pas tant le pouvoir de l’argent qui m’intéresse ici que son utilisation domestique, autrement dit sa présence dans les foyers et sa circulation, ou plus exactement la façon de le répartir à l’intérieur même de la famille.
Qui, enfant, n’a pas emprunté quelques centimes dans « le porte-monnaie des courses », autrement dit : comment glanait-on gentiment quelque sous pour s’offrir de minuscules ou nécessaires plaisirs tout en échappant au contrôle familial ? - ceci dit à travers les souvenirs d’une enfance au sein d’une famille nombreuse toujours un peu « juste », à qui les dépenses quotidiennes étaient comptées. Vous aurez compris que plutôt que de parler d’une monnaie abstraite et de la notion d’argent en général, j’aimerais rester sur les modalités sociales de son usage et redire, ainsi que nous l’expérimentons chaque jour, qu’il n’y a pas une monnaie mais des monnaies que l’on qualifie d’argent du ménage ou encore d’argent domestique. Cela peut-être bien évidemment de l’argent reçu contre son travail, mais aussi de l’argent emprunté, et beaucoup plus rarement de l’argent arraché, voire de l’argent volé ou considéré comme volé. Pour l’ethnologue, l’argent pour vivre ou survivre au sein d’une communauté, d’une famille ou d’un couple est très chargé symboliquement et socialement.
Viviana Zelizer, une socio-économiste de l’université de Princeton, dans son magistral ouvrage « La signification sociale de l’argent »(Seuil, 2005), s’est particulièrement intéressée aux études qui ont été menées sur le rapport à l’argent des femmes américaines au foyer de la fin du XIXe à la moitié du XXe, et a débusqué un certain nombre d’aventures liées à nos poches dont ma génération peut encore témoigner. En utilisant la situation des femmes au foyer, cette chercheuse a pu rompre avec l’idée de neutralité de la monnaie - dont l’adage idiot servant presque comme une conjuration à la neutraliser permet de déclarer, dés que son utilisation semble trouble, « l’argent n’a pas d’odeur » - et montrer à quel point l’utilisation de la monnaie renvoie à des pratiques sexuellement différenciées dites aujourd’hui pratiques de genre. Les rapports entre les sexes et le rapport à l’argent, ainsi que la transformation de ces rapports, sont liés à la transformation des conditions d’accès des femmes à l’argent. La question est bien de savoir comment circule l’argent dans l’univers social, quels sont les mécanismes domestiques qui le font circuler d’une poche à l’autre. Voici quelques exemples de pratiques individuelles qui ne manqueront pas, j’en suis sûr, de parler à beaucoup (de femmes) des générations les plus anciennes et peut-être même pas si anciennes…
Il s’agit d’histoires d’épouses américaines et anglaises qui ont eu maille à partir avec les poches de leurs maris ; histoires qui nous permettront de revenir sur le marquage domestique de la monnaie et qui montrent les batailles secrètes, intimes, opiniâtres, livrées au sein des foyers à propos et autour de l’argent. Un magazine américain de 1928 rappelle que « la mention de l’argent a provoqué plus de querelles entre maris et femmes que l’évocation de danseuses de music-hall, de serveuses blondes, de danseurs aux cheveux gominés, de représentants de commerce ». En effet, entre 1880 et 1920 les conflits pécuniaires devinrent un motif de divorce grandissant aussi bien dans les milieux riches que dans les milieux pauvres aux Etats-Unis, et à mon avis ailleurs aussi. La question était de savoir si une femme mariée pouvait toucher une allocation. Et si elle économisait sur les dépenses ménagères, les sommes épargnées lui appartenaient en propre ou pas ? Ou bien : est-ce qu’une femme était habilitée à acheter quoi que ce soit seule ou au nom de son mari ? Pouvait-elle obtenir un crédit à son nom dans un magasin ? On poussa la question jusqu’à se demander si une femme pouvait légalement posséder un dollar. De là découla naturellement la question de savoir si une femme qui dérobait de l’argent dans la poche de pantalon de son mari était une voleuse ou non.
On rapporte le cas en Angleterre d’une épouse qui avait été battue à mort par son mari pour la punir d’avoir pris quatre shillings dans sa poche sans le lui demander. Pathétique également, bien que drolatique, cette aventure qui se produisit en 1905 à Buffalo : une femme était obligée, pour obtenir un peu d’argent, de dérober quelques pièces de menue monnaie dans la poche du pantalon de son mari pendant qu’il dormait. Celui-ci, excédé par ces « retraits nocturnes », décida de placer une tapette à souris dans sa poche… A deux heures du matin le piège se referma sur les doigts de son épouse. Une scène s’ensuivit et au matin chacun décida pour des raisons différentes d’aller porter plainte devant la police de Buffalo. Le tribunal fut saisi de l’affaire. Le juge débouta la plaignante et le mari eut gain de cause sur le motif que « les maris ont le droit de protéger le contenu de leurs poches au moyen de ratières ». En 1920 les annales judiciaires retiennent l’histoire d’une femme d’une quarantaine d’années qui avait dérobé dix dollars dans le pantalon de son conjoint pour pouvoir se payer un billet de train pour New York. Elle écopa de quatre mois de prison pour ce larcin.
Si on reprenait les chroniques judiciaires de tous les pays du monde, je crains fort qu’on y recense des milliers de cas de femmes punies pour avoir fréquenté les poches d’un homme pour des motifs semblables : avoir un tout petit peu d’argent à soi. Un vaste registre de stratégies financières typiquement féminines existe (et à mon avis est loin d’être tari aujourd’hui) comme, entre autres exemples, celles de gonfler une facture de couturière d’une dizaine de dollars, de shillings ou de francs avec l’accord de cette dernière, ou d’aller vendre en cachette des fruits, des gâteaux ou des babioles, pour ne pas parler, en dehors de la prostitution secrète et épisodique, de la tarification des câlins à son mari. Et ceci vaut, rapportent les études, aussi bien pour des femmes dans un milieu riche que dans un milieu pauvre. Dans les ménages appartenant aux classes moyennes et supérieures, les questions d’argent semblaient être jusqu’à une époque récente du ressort des maris avant tout. Il est à noter toutefois que dans les ménages ouvriers les épouses étaient souvent appelées à se comporter comme les « caissières » de leur famille pour gérer au plus près des revenus limités et souvent incertains.
Ce n’est que récemment que les anthropologues ont commencé à travailler et à dénoncer l’idée bien installée que la devise, l’argent moderne, pouvait être culturellement neutre. Par rapport à l’idée arrêtée aujourd’hui d’un argent neutre et semblable pour tous, leurs travaux montrent au contraire l’incroyable hétérogénéité de l’argent et ses multiples significations symboliques modelées par une matrice culturelle. Ils nous montrent également qu’il est vain de distinguer les monnaies spéciales primitives telles que les cauris, barres de cuivre, cailloux, cochons ou autres monnaies-marchandises de notre argent contemporain légal et généralisé. Des enquêtes ont montré que les ressources dont dispose le foyer sont souvent compartimentées dans des « cachettes » différentes, en fonction des types d’utilisations qui leur étaient octroyés. Même si les monnaies multiples du monde contemporain sont moins visiblement identifiables que celles des sociétés traditionnelles énoncées plus haut, leurs frontières invisibles fonctionnent aussi bien que celles de tous ces objets. Dans tout système domestique et bancaire l’argent a des destinations particulières et est perçu de façons différentes par ses utilisateurs, même s’il existe des différences quantitatives évidentes. La liste du vocabulaire concernant l’argent, ou plutôt ses destinations, est longue : rançons, pots de vin, pourboires, dommages, intérêts, etc ; toutes quantités d’argent très dissemblables mais qui, sans ces distinctions qualitatives, rendraient le monde de l’argent totalement indéchiffrable. Il se trouve que le marquage monétaire est un phénomène individuel lié à des comptabilités mentales souvent indéchiffrables pour d’autres personnes, ce qui fait que les individus, quelle que soit leur inscription sociale, distinguent un genre d’argent d’avec un autre. Pour reprendre Marcel Mauss dans son article sur « les origines de la notion de monnaie » paru en 1914, l’argent est essentiellement un fait social et est corrélé à une vaste gamme de relations sociales.
Pour revenir à notre réalité contemporaine nous savons tous que plus l’économie de la consommation a multiplié le nombre des biens en circulation, plus leur pouvoir d’attraction a grandi ; plus le revenu des ménages a augmenté, plus la répartition de l’utilisation adéquate des revenus familiaux a été tenue pour une tâche urgente. C’est pour cela qu’aujourd’hui (et avant la crise !), dans les ménages, bien dépenser parait plus important que gagner assez. Pour que cela se produise, il faut se souvenir que les spécialistes de l’économie domestique ont diffusé dans les salles de classe, les manuels, les articles de magazine, la radio, et tout organe de diffusion de masse, les principes du consumérisme éclairé jusqu’à ce que le statut de l’argent change. Ceci explique que le nombre de dollars économisés n’a plus beaucoup de sens de nos jours, sinon celui de se procurer à l’équivalent des biens nouveaux présentés comme absolument nécessaires à notre vie moderne. Quand la lessiveuse ou le matelas cessa de servir à remiser son trésor familial, on commença à s’équiper d’une comptabilité « sérieuse » : livres de comptes, feuilles de prévision budgétaire, assistance d’un comptable-conseiller, et invention de toutes sortes de stratégies appropriées à la différenciation des multiples monnaies à usages proprement domestiques. Dans cet élan de modernisation, l’appel à des institutions extérieures au foyer se fit de plus en plus grand : caisse d’épargne et comptes orientés servant par exemple au financement des études des enfants, aux assurances, à l’achat d’une voiture, aux soldes ; puis avec le trop plein : achats de « bons » divers jusqu'à ce que les objectifs deviennent moins vitaux et qu’avec la société de loisirs de nouvelles orientations et des spécifications ne s’opèrent, comme la mise de côté de sommes pour les vacances d’été, les vacances à la neige, le voyage annuel à l’étranger, Noël, etc.
Où en sommes-nous avec nos argents - en poche ou non - en ce début du XXIe siècle ? Y a-t-il une crise de l’argent ? Et si oui comment parler de crise à des consommateurs dont l’unique idée et le but ultime sont de consommer, au risque derendre la terre invivable et de ne plus exister à plus ou moins court terme ? L’anthropologue Arjun Appadurai, dans son livre « Après la Colonisation. Les conséquences culturelles de la globalisation » (Payot, 2001), a raison de dire qu’il n’y a désormais guère d’échappatoires aux rythmes de la production industrielle. Partout où le loisir est vraiment disponible et socialement acceptable, ce qui est requis n’est pas seulement du temps libre, mais le revenu dont l’individu peut disposer pour s’assurer ses loisirs dont la consommation fait désormais intégralement partie. Dans nos sociétés industrielles où la dette du consommateur a atteint une taille monstrueuse, les institutions financières ont exploité jusqu’à la crise récente la tendance des consommateurs à dépenser avant plutôt qu’après avoir épargné dans Le Monde du 11 novembre 2009 un article d’Anne Michel intitulé « Crédits à la consommation : les impayés se multiplient », rapporte que les ménages modestes, ceux là même qui ne peuvent se passer de crédits, peinent à rembourser leurs mensualités. Quant aux petites boutiques opérant sur Internet avec desslogans jugés pousse-au-crime promettant « une vie meilleure » à des internautes en recherche d’argent, ils ont pour cette raison été conduits à se montrer un peu plus scrupuleux dans l’octroi des crédits. .Il est à noter que cette stratégie « spéciale crise » répond autant à l’intérêt des emprunteurs qu’à celui des prêteurs, et qu’un pôle d’accompagnement des clients a été mis sur pied pour aider à passer cette crise. De leur côté les consommateurs ne se perçoivent pas comme de simples dupes d’un système exploiteur de prêt financier. La dette est désormais reconnue par tous, non plus comme une chose infamante mais, au contraire, comme une expansion du revenu obtenu par d’autres moyens que le travail propre. Bien sûr des aléas interviennent parfois, faisant souffrir l’une ou l’autre des parties du binôme désormais inséparable ; aléas qui servent d’une certaine façon de soupapes périodiques au système : les effondrements majeurs par exemple pénaliseront les « prêteurs », et inversement une explosion brutale des taux d’intérêt viendra pénaliser en retour les consommateurs. Ceci explique en partie pourquoi dans les sociétés dites nanties est en train d’émerger une bataille gigantesque entre consommateurs et prêteurs, bataille qui a pour enjeu des compréhensions
rivales d’un futur imaginé presque totalement comme une simple marchandise.
(à suivre)
dimanche 27 septembre 2009
EN ROUTE VERS LE POSTHUMAIN (suite)
SE DONNER CORPS ET BÊTE…
J’en viens au fait : intéressons nous a une journée d’un de ces joyeux cybernaute retardataire landa, dans laquelle je me permettrai quelques écarts interprétatifs plus ou moins savants, pour essayer de voir comment nous fonctionnons quotidiennement à l’intérieur de nos maisons, que dis-je, de nos chambres en cette entrée dans le XXI e siècle
Je n’irai pas chercher d’acteurs éloignés : comme beaucoup, chaque matin, lorsque je me lève je vais ouvrir ma boîte à lettre, mon « mail », là sur mon bureau, dans mon ordinateur, exactement comme si j’allais voir si j’ai du courrier dans ma boite à lettre bien réelle. L’extraordinaire de la chose est que ma machine commence par me faire des politesses : elle me souhaite la bienvenue, m’avise de la présence de mail avec sa voix electrosuave et me laisse accéder à mes nouvelles après un clic ou deux qu’il ne faut pas rater. Disons que moi et mon ordinateur faisons société, et le reste du monde avec nous. Il faut reconnaître que l’un des discours le plus mis en avant de la cyberculture est celui de l’hospitalité comme le remarque Antonio Casill dans son bel article « Le discours de l’hospitalité dans la cybercultere »(Société, N°83, 2004),discours dont les indices les plus incontestables sont les termes employés dans toutes les langues pour décrire l’activité de consultation des données stockées et transmises sur le réseau Internet , à savoir : home, visita, besuchen, community, acceuil, address, indirizzo, zugang, accés, host, hébergement , privacy, sécurité, libro de visitars , etc.
Et nous voila convié à bord, invité à pénétrer non plus dans le vide sidéral d’une Toile étrangère mais au contraire accueillit dans « un espace particulièrement colmaté, un abri, un emplacement clos qui puisse s’opposer à l’ouvert, à l’étendue dépeuplée que le voyageur traverse. Pas besoin de maison ou de murs afin de marquer la séparation entre l’extérieur et l’endroit de réception (…) Au degré zéro de l’espace accueillant, il y a une aire symboliquement circonscrite. » (Casilli) L’hospitalité ne se déroule pas dans le vide, je regarde ma page d’accueil en termes de lieu de réception selon le futur vieux précepte cybernétique : « pensez à votre futur site web comme à un cyber-foyer ! » Une maison de décoration intérieure américaine de sites web propose même un guide de conception développant l’idée qu’il faut penser son site « comme un lieu où les amis et les invités peuvent se détendre et s’amuser en votre compagnie ». Suivent quelques conseils : « il faut inviter les hôtes à rentrer, les entretenir avec des jeux et des plaisanteries, associer dans la réception des visiteurs, les membres de la famille, les subordonnés et les alliés. »
Nous voila reçu sur la Toile comme si nous y étions ! Commence alors une cérémonie du don particulière (ou a mon avis l’aspect primitif du potlatch est à réviser) le don de son propre temps, de sa propre connaissance, le don aussi de son propre disque dur et plus encore de son propre corps. Antonio Cassilli remarque que « cette socialité hospitalière présuppose un procédé de dématérialisation du corps de l’usager des nouvelles technologies, fondant une identité corporelle post-humaine. » Il n’hésite pas citer un adage en latin : : « posthumani nihil a me alienum puto », rien de ce qui touche à la posthumanité ne m’est étranger. Et nous voila, sans que l’on s’en soit rendu compte, en train d’entrer dans un posthumanisme, dans une histoire nouvelle qui « préconise la fin du rôle central de l’être humain dans l’ordre culturel actuel »(Casilli) L’articulation homme-machine intelligentes « a prolongé la notion de posthumain jusqu’à inclure les être « autres » , les étrangers et les combinaisons de l’humain/non humain » (Casilli) dans la grande famille du monde , la world familly.
Il y a quelque chose a entendre ici qui est encore de l’ordre du religieux :
« L’hospitalité cyber s’oppose décidemment à l’hospitalité chrétienne basée sur l’instance supérieure de l’union de tous les hommes en dieu. Les voyageurs hébergés dans les nœuds du réseau Internet ne sont pas des frères, ils sont des xenoï , des étrangers. Ils ne sont pas non plus des pèlerins se rendant à un endroit précis, ils sont assimilés aux nomades errants dans un territoire indéfinissable et incartographiable parce que fluide et toujours en mutation. L’hôte-confrére chrétien ajoute Casilli, est à l’hôte étranger cybernaute comme le touriste est à l’égaré. ». La « real Life » serait suspendue le temps du voyage dans le cyberespace et avec lui le corps, ce corps bien réel qui s’est assis sur une chaise et qu’on se met à oublier, rivé à un écran luminescent. “Les voyageurs des autoroutes virtuelles ont au moins un corps de trop, celui aujourd’hui considérablement sédentaire, le corps à base carbonique devant le clavier, souffrant la faim, la corpulence, la maladie, le vieillissement et finalement la mort. L’autre corps, un fac-similé à base de silice branchée dans le domaine immatériel des données et des superpouvoirs, même si virtuellement, il est immortel –ou plutôt le corps choisi, une incarnation virtuelle « disjointe » du corps physique, est un logiciel capable de faire face à d’infinies morts » Cette dichotomie entre le vieux corps obstinément voué à vivre dans une « réalité » déficitaire et un nouveau corps régénéré par les technologies dans un habitat virtuel est au centre de la relation animale –hommes – espaces comme le notent Corinne C Boujot et Antonio Casilli dans « Interfaces bestiales : rôle et place des animaux dans l’imaginaire des mondes virtuels »,( Espaces et Sociétés, n°110-11, 2002, L’Harmattan) . « La réalité virtuelle permet à nos propres notions d’esprit et de « corps spirituel » de s’accroître jusqu’au niveau que nous avons rejoint dans le développement de notre concept de corps physique, au cours de plusieurs milliers d’années dans le cadre de notre civilisation actuelle (…) dans les mondes virtuels, vous pouvez vous changer en langoustine , en tarentule, en gazelle et apprendre à contrôler ce nouveau corps. » ( Boujot-Casilli)
Le fantasme de technologies informationnelles toutes puissantes permet sans grande difficulté le passage à un nouvel imaginaire de la corporéité tant l’anxiété sur les perditions possibles du corps se dissout devant la promesse d’une santé parfaite. Une santé aussi virtuelle que vertueuse puisque le corps nouveau se veut dépourvu de vices, voué à un culte du bien technologique, annonciateur d’une ère fraternelle qui s’opposera à la souffrance constitutive du monde ( (Boujout Casilli) Plus de compromis avec la réelle chaire , fini l’ancien modèle corporel. Dans un espace « au-delà » des problèmes d’un monde trouble, il s’agit d’un corps régénéré réhabité et réinstallé dans une autre topographie que la seule alors connue. Je parle ici de la terre, de la topographie terrestre qui va rejoindre et se confondre dans la vision qu’on s’en fait désormais avec l’infosphére qui enveloppe la planète. On parle d’ailleurs de ce phénomène dans les théories de l’ « embodiment » (incarnation et incorporation) ; ces théories affirment que ce dont notre corps ne peut faire l’expérience est appréhendé à travers des analogies et des métaphores qui constituent le seul moyen de donner sens à des concepts sans réalité tangible, virtuels ! Ce sont sur ces catégories familières que se greffent les modes de pensée nouveaux issus de la Toile.
N’oublions pas qu’Internet n’offre que des moyens nouveaux pour atteindre des buts qui ne le sont pas : trouver (moteur de recherche) , communiquer ( mails, , recherches de services et ,par les « liens », se déplacer et répondre ou transmettre de l’information ! il est intéressant de noter que la notion d’original , du document unique, de la chose matérielle qui longtemps persista, avec les ordinateurs se dissout dans la profusion du même possible. Sur la fin de l’authentique, Internet en rajoute en contribuant à une dématérialisation progressive d’objet de possession ; L’objet de possession s’est dématérialisé jusqu’à n’être plus qu’une simple adresse accessible à tout moment.
Derrière (ou dedans) mon écran, les distances se dissolvent, les lieux se métamorphosent et les actions changent de nature. Internet, en effet, change la conception de la distance et le rapport au temps. L’éloignement physique perd toute pertinence et l’instantanéité devient la règle : les adresses postales sur la Toile rendent leurs détenteurs immédiatement accessibles et les mettent à égale distance, tous et toutes à portée de courriel : réserver une chambre d’hôtel, passer une commande, consulter la météo, une notice, son horoscope ou les nouvelles du jour, écrire à Chichery ou à New York, tout peut se faire de chez soi. Désormais on est à côté de tous et à portée de tout au point que le « où » et le « quand » se rapprochent.
La Toile conduit également à dissocier matérialité et possibilité d’action qui semblait consubstantielle, inséparables .Les objets immatériels deviennent des supports d’action au même titre que les objets matériels dans l’environnement quotidien. On peut désormais remplir son caddie dans une épicerie virtuelle et recevoir chez soi ses courses, choisir et essayer des lunettes de vue, visiter des monuments, des villages, aimer, etc. Bref on peut tout faire, tout avoir, tout connaître (croit-on). C’est le « tout faire » qui ici m’intéresse , cette drôle de présence-absence qui nous fait exister autrement dans nos relations.
SE DONNER CORPS ET BÊTE…
J’en viens au fait : intéressons nous a une journée d’un de ces joyeux cybernaute retardataire landa, dans laquelle je me permettrai quelques écarts interprétatifs plus ou moins savants, pour essayer de voir comment nous fonctionnons quotidiennement à l’intérieur de nos maisons, que dis-je, de nos chambres en cette entrée dans le XXI e siècle
Je n’irai pas chercher d’acteurs éloignés : comme beaucoup, chaque matin, lorsque je me lève je vais ouvrir ma boîte à lettre, mon « mail », là sur mon bureau, dans mon ordinateur, exactement comme si j’allais voir si j’ai du courrier dans ma boite à lettre bien réelle. L’extraordinaire de la chose est que ma machine commence par me faire des politesses : elle me souhaite la bienvenue, m’avise de la présence de mail avec sa voix electrosuave et me laisse accéder à mes nouvelles après un clic ou deux qu’il ne faut pas rater. Disons que moi et mon ordinateur faisons société, et le reste du monde avec nous. Il faut reconnaître que l’un des discours le plus mis en avant de la cyberculture est celui de l’hospitalité comme le remarque Antonio Casill dans son bel article « Le discours de l’hospitalité dans la cybercultere »(Société, N°83, 2004),discours dont les indices les plus incontestables sont les termes employés dans toutes les langues pour décrire l’activité de consultation des données stockées et transmises sur le réseau Internet , à savoir : home, visita, besuchen, community, acceuil, address, indirizzo, zugang, accés, host, hébergement , privacy, sécurité, libro de visitars , etc.
Et nous voila convié à bord, invité à pénétrer non plus dans le vide sidéral d’une Toile étrangère mais au contraire accueillit dans « un espace particulièrement colmaté, un abri, un emplacement clos qui puisse s’opposer à l’ouvert, à l’étendue dépeuplée que le voyageur traverse. Pas besoin de maison ou de murs afin de marquer la séparation entre l’extérieur et l’endroit de réception (…) Au degré zéro de l’espace accueillant, il y a une aire symboliquement circonscrite. » (Casilli) L’hospitalité ne se déroule pas dans le vide, je regarde ma page d’accueil en termes de lieu de réception selon le futur vieux précepte cybernétique : « pensez à votre futur site web comme à un cyber-foyer ! » Une maison de décoration intérieure américaine de sites web propose même un guide de conception développant l’idée qu’il faut penser son site « comme un lieu où les amis et les invités peuvent se détendre et s’amuser en votre compagnie ». Suivent quelques conseils : « il faut inviter les hôtes à rentrer, les entretenir avec des jeux et des plaisanteries, associer dans la réception des visiteurs, les membres de la famille, les subordonnés et les alliés. »
Nous voila reçu sur la Toile comme si nous y étions ! Commence alors une cérémonie du don particulière (ou a mon avis l’aspect primitif du potlatch est à réviser) le don de son propre temps, de sa propre connaissance, le don aussi de son propre disque dur et plus encore de son propre corps. Antonio Cassilli remarque que « cette socialité hospitalière présuppose un procédé de dématérialisation du corps de l’usager des nouvelles technologies, fondant une identité corporelle post-humaine. » Il n’hésite pas citer un adage en latin : : « posthumani nihil a me alienum puto », rien de ce qui touche à la posthumanité ne m’est étranger. Et nous voila, sans que l’on s’en soit rendu compte, en train d’entrer dans un posthumanisme, dans une histoire nouvelle qui « préconise la fin du rôle central de l’être humain dans l’ordre culturel actuel »(Casilli) L’articulation homme-machine intelligentes « a prolongé la notion de posthumain jusqu’à inclure les être « autres » , les étrangers et les combinaisons de l’humain/non humain » (Casilli) dans la grande famille du monde , la world familly.
Il y a quelque chose a entendre ici qui est encore de l’ordre du religieux :
« L’hospitalité cyber s’oppose décidemment à l’hospitalité chrétienne basée sur l’instance supérieure de l’union de tous les hommes en dieu. Les voyageurs hébergés dans les nœuds du réseau Internet ne sont pas des frères, ils sont des xenoï , des étrangers. Ils ne sont pas non plus des pèlerins se rendant à un endroit précis, ils sont assimilés aux nomades errants dans un territoire indéfinissable et incartographiable parce que fluide et toujours en mutation. L’hôte-confrére chrétien ajoute Casilli, est à l’hôte étranger cybernaute comme le touriste est à l’égaré. ». La « real Life » serait suspendue le temps du voyage dans le cyberespace et avec lui le corps, ce corps bien réel qui s’est assis sur une chaise et qu’on se met à oublier, rivé à un écran luminescent. “Les voyageurs des autoroutes virtuelles ont au moins un corps de trop, celui aujourd’hui considérablement sédentaire, le corps à base carbonique devant le clavier, souffrant la faim, la corpulence, la maladie, le vieillissement et finalement la mort. L’autre corps, un fac-similé à base de silice branchée dans le domaine immatériel des données et des superpouvoirs, même si virtuellement, il est immortel –ou plutôt le corps choisi, une incarnation virtuelle « disjointe » du corps physique, est un logiciel capable de faire face à d’infinies morts » Cette dichotomie entre le vieux corps obstinément voué à vivre dans une « réalité » déficitaire et un nouveau corps régénéré par les technologies dans un habitat virtuel est au centre de la relation animale –hommes – espaces comme le notent Corinne C Boujot et Antonio Casilli dans « Interfaces bestiales : rôle et place des animaux dans l’imaginaire des mondes virtuels »,( Espaces et Sociétés, n°110-11, 2002, L’Harmattan) . « La réalité virtuelle permet à nos propres notions d’esprit et de « corps spirituel » de s’accroître jusqu’au niveau que nous avons rejoint dans le développement de notre concept de corps physique, au cours de plusieurs milliers d’années dans le cadre de notre civilisation actuelle (…) dans les mondes virtuels, vous pouvez vous changer en langoustine , en tarentule, en gazelle et apprendre à contrôler ce nouveau corps. » ( Boujot-Casilli)
Le fantasme de technologies informationnelles toutes puissantes permet sans grande difficulté le passage à un nouvel imaginaire de la corporéité tant l’anxiété sur les perditions possibles du corps se dissout devant la promesse d’une santé parfaite. Une santé aussi virtuelle que vertueuse puisque le corps nouveau se veut dépourvu de vices, voué à un culte du bien technologique, annonciateur d’une ère fraternelle qui s’opposera à la souffrance constitutive du monde ( (Boujout Casilli) Plus de compromis avec la réelle chaire , fini l’ancien modèle corporel. Dans un espace « au-delà » des problèmes d’un monde trouble, il s’agit d’un corps régénéré réhabité et réinstallé dans une autre topographie que la seule alors connue. Je parle ici de la terre, de la topographie terrestre qui va rejoindre et se confondre dans la vision qu’on s’en fait désormais avec l’infosphére qui enveloppe la planète. On parle d’ailleurs de ce phénomène dans les théories de l’ « embodiment » (incarnation et incorporation) ; ces théories affirment que ce dont notre corps ne peut faire l’expérience est appréhendé à travers des analogies et des métaphores qui constituent le seul moyen de donner sens à des concepts sans réalité tangible, virtuels ! Ce sont sur ces catégories familières que se greffent les modes de pensée nouveaux issus de la Toile.
N’oublions pas qu’Internet n’offre que des moyens nouveaux pour atteindre des buts qui ne le sont pas : trouver (moteur de recherche) , communiquer ( mails, , recherches de services et ,par les « liens », se déplacer et répondre ou transmettre de l’information ! il est intéressant de noter que la notion d’original , du document unique, de la chose matérielle qui longtemps persista, avec les ordinateurs se dissout dans la profusion du même possible. Sur la fin de l’authentique, Internet en rajoute en contribuant à une dématérialisation progressive d’objet de possession ; L’objet de possession s’est dématérialisé jusqu’à n’être plus qu’une simple adresse accessible à tout moment.
Derrière (ou dedans) mon écran, les distances se dissolvent, les lieux se métamorphosent et les actions changent de nature. Internet, en effet, change la conception de la distance et le rapport au temps. L’éloignement physique perd toute pertinence et l’instantanéité devient la règle : les adresses postales sur la Toile rendent leurs détenteurs immédiatement accessibles et les mettent à égale distance, tous et toutes à portée de courriel : réserver une chambre d’hôtel, passer une commande, consulter la météo, une notice, son horoscope ou les nouvelles du jour, écrire à Chichery ou à New York, tout peut se faire de chez soi. Désormais on est à côté de tous et à portée de tout au point que le « où » et le « quand » se rapprochent.
La Toile conduit également à dissocier matérialité et possibilité d’action qui semblait consubstantielle, inséparables .Les objets immatériels deviennent des supports d’action au même titre que les objets matériels dans l’environnement quotidien. On peut désormais remplir son caddie dans une épicerie virtuelle et recevoir chez soi ses courses, choisir et essayer des lunettes de vue, visiter des monuments, des villages, aimer, etc. Bref on peut tout faire, tout avoir, tout connaître (croit-on). C’est le « tout faire » qui ici m’intéresse , cette drôle de présence-absence qui nous fait exister autrement dans nos relations.
L’être humain est désormais équipé de prothèses cybernétiques, bien différentes des fourchettes, des cuillères ou d’une voiture ; ce sont des prothèses qui lui sont données au même titre que ses autres membres. Durant la fraction temporelle de son existence, infime à l’échelle de l’évolution humaine, la prothèse Internet est pensée par analogie au monde sensible. Mais constituer sans cesse de nouvelles sources d’ analogie peut à son tour devenir source et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on ne puisse plus se passer du virtuel. Difficile après ça de savoir qui du
virtuel ou du matériel est le plus réel ?
virtuel ou du matériel est le plus réel ?
DERRIERE TARZAN IL Y A BURROUGHS ,L’AMERIQUE ET LE COLONIALISME
Les aventures de Tarzan n’ont jamais été bien vues dans les écoles ni considérées par l’Académie comme de la littérature, à l’exacte inverse de celles de Mowgli du Livre de la jungle de Kipling (1865-1936), auteur qui obtint le prix Nobel de Littérature en 1907 et fut à l’origine d’un engouement pour l’histoire particulière de cet enfant sauvage. Mowgli fit en effet réfléchir les « civilisés » sur le thème : existe-t-il des « humains différents » dont on ignorerait l’existence, survivants dissimulés d’un stade archaïque ou anticipation d’un lointain futur ? Le nom même d’Edgar Rice Burroughs (1875-1950), en dehors d’un cercle restreint d’amateurs de science-fiction, est assez peu connu. Par contre, celui de Tarzan résonne toujours tout autour de la planète grâce à la production multimédia contemporaine. Cela n’empêcha pas Burroughs de vendre de son vivant plus de trente millions d’ouvrages publiés dans une trentaine de langues.
À l’âge de trente-six ans, l’écrivain chercha le moyen de devenir un auteur à succès. En 1911, il entama des recherches à la Chicago Public Library pour s’ouvrir de nouveaux horizons. Il découvrit In Darkest Africa de Henry Morton Stanley (1841-1904). Bien entendu The Jungle Book, 1894, de Rudyard Kipling, il lut aussi Jack London The Call of the Wild et The Sea Wolf, le premier racontant l’histoire d’un chien « civilisé » retournant à l’état sauvage, le second narrant l’aventure d’un homme sophistiqué forcé à s’adapter à la vie primitive. Il s’enticha d’un article du grand anthropologue anglais E. Burnett Tylor intitulé « Wild Men and Beast Children », 1863 et de Childhood of Fiction de J. A. MacCulloch, 1905. Il a surtout été marqué par l’histoire de Romulus et Remus et le récit de « Dan, the Monkey Man », un jeune homme qui racontait qu’il avait été adopté par un groupe de grands Singes quelque part sur la côte africaine. Enfin, comme l’éditeur Robert Hobart Davis lui proposait sept cents dollars pour qu’il écrive des nouvelles dans son magazine, Burroughs imagina :« Un enfant d’une race solide, marqué par un caractère héréditaire plein de finesse et de noblesse […], transféré dans un environnement le plus diamétralement opposé à son milieu d’origine que j’ai pu imaginer. » Nous étions en 1912, il venait d’inventer Tarzan of the Apes qui parut à Chicago chez A. C. McClurg & Company en 1914. Ses aventures coururent sur vingt-six volumes jusqu’en 1940.
L’histoire de Tarzan est donc née de l’imagination fertile de l’Américain Edgar Rice
Burroughs et du contexte historique dans lequel il la plaça ainsi que de l’époque à
laquelle il l’écrivit depuis les Etats-Unis.
Culotte, colonialisme et cannibalisme
Burrougs aprés avoir décrit l'enfance de Tarzan parmi les anthropoïdes ajoute qu'« Au fond de son petit cœur d’Anglais montait également le profond désir de couvrir sa nudité de VÊTEMENTS, car il avait appris dans ses livres d’images que tous les HOMMES en portaient, alors que les SINGES et tous les autres êtres vivants allaient nus. Donc les VÊTEMENTS devaient sans doute être un signe de grandeur, l’insigne de la supériorité de l’HOMME sur tous les autres animaux […]
Il pensait que s’il voulait devenir HOMME il fallait qu’il respecte les préceptes de ce manuel d’apprentissage qu’il étudiait si assidûment puisqu’il ne pouvait exister d’autre motif pour se couvrir de choses aussi hideuses. »
C’est à la suite d’un orage, dans le froid et l’inconfort d’une pluie battante qui glisse mieux sur des poils que sur la peau nue de Tarzan, dont il était inconsciemment fier, écrit Burroughs, « car elle prouvait son appartenance à une race puissante ». Il n’empêche que depuis son enfance, « il était constamment partagé entre le désir de rester nu, pour que tous voient la preuve de ses origines, et celui de se conformer aux usages de sa race et de revêtir ces ornements hideux et malcommodes ».
Or, cette nuit-là « dans la tête de Tarzan, une étincelle venait de jaillir : il avait compris le pourquoi des VÊTEMENTS, comme il aurait été protégé du froid et de la pluie dans la peau chaude de Sabor ! » Du même coup, il découvre ce qu’est peut-être le climat continental tempéré de ces pays éloignés qu’il a vu dans les livres et la raison réelle du besoin de vêtements pour les hommes y habitant Son obsession de se vêtir ou plutôt de revêtir une autre peau n’est pas nouvelle, Il pensa même se faire une cape royale de la peau de la lionne Sabor qu’il avait tué. Mais il dut y renoncer car « Tarzan ne connaissait rien au tannage, cela va sans dire » et la dépouille ne put servir à habiller le roi des animaux, ni l’homme en devenir.
C’est finalement une autre proie qui va lui fournir son premier vêtement, du prêt-à-porter qu’il n’aura pas besoin de tailler mais juste d’enfiler. Il s’agit d’un bipède dont il a appris à dessiner le nom HOMME, « à la peau glabre », foncée et portant un arc. Dans l’histoire, il s’agit de Kalonga, fils du roi Mbonga, grand chasseur et assassin de Kala, la mére adoptive de Tarzan. En le pistant, Tarzan découvre pour la première fois dans la forêt des empreintes de pieds nus qui ne sont pas les siennes et, d’une certaine façon, se met sur ses propres traces.
Enfin, il aperçoit « l’étrange créature [...] Il lui ressemblait tellement [...] et pourtant ses traits et sa couleur étaient différents ! » De plus il ne ressemble pas aux images qu’il a vues dans ses livres. « Tarzan ne reconnut pas tant le NOIR que l’ARCHER de ses livres d’images.
A est un Archer...C’était merveilleux ! »
La découverte d’un autre soi-même l’enthousiasme au point que, oubliant un temps sa vengeance contre l’assassin de sa mère adoptive, il observe son premier semblable avec passion. Avec lui, il découvre la domestication du feu et la première « espèce cuisinière » doublée de l’idée sans doute réservée aux humains de profusion ou de gâchis puisque, « son estomac bien rempli, [...] il abandonna le reste sur le sol. » Tarzan se sent moins bête que lui, descend de son arbre et en animal consciencieux et prévoyant : « Il dévora sa viande crue et enfouit les restes de Horta (le sanglier) sous le sol pour les retrouver à son retour. »
Ce n’est que plus tard que Tarzan le capture au lasso. En chasseur consciencieux « Tarzan acheva silencieusement sa victime. Puis il la dépouilla de ses armes et de ses ornements et, oh joie ! d’une magnifique culotte de daim qu’il enfila immédiatement. »
Tarzan « culotté » et, de ce fait, encore un peu plus homme, s’enhardit :
« Jetant le corps sur son épaule, il se dirigea lentement vers le village... »
Il s’agit bien de « corps » et non de « proie ». Sa victime déculottée va passer au statut de « cadavre » humain et jouer son rôle à part entière dans la dernière frasque de Tarzan pour « terroriser les Noirs ». Content de son astuce et quelque peu grisé par la possession d’un vêtement, Tarzan pense « comme il aurait aimé retourner dans sa tribu et se pavaner sous les regards envieux des singes ». Il n’empêche que : « Maintenant il était vraiment habillé comme doit l’être un homme, et personne ne pouvait plus douter de sa haute naissance. »
L’histoire est pourtant plus complexe que cela. L’homme qu’il a tué et dépouillé de sa culotte appartient à une humanité coloniale et chrétienne. Cette culotte est empruntée à un Africain rhabillé par la colonisation et la chrétienté au nom de la civilisation et de la pudeur, quoi qu’il semble qu’il s’agisse plutôt ici d’un pagne traditionnel en daim et non de coton. Qu’importe, la culotte de ce Noir appartenait, précise Burroughs, a un groupe de plusieurs centaines de réfugiés ou plutôt de résistants a l’oppression coloniale. « La genèse de leur fuite commençait le jour où, excédés d’avoir à fournir toujours plus de caoutchouc et d’ivoire à l’oppresseur blanc, ils s’étaient soulevés et avaient massacré un officier européen [Crime de lèse majesté !] et le détachement de troupes indigènes qu’il commandait [Crime plus pardonnable et secondaire]. »
Le contexte colonial des « Tarzan » comme dans toute l’œuvre de Burroughs n’est pas négligeable et, d’une certaine façon sa dénonciation, retenue mais présente, par un Américain moderne plus au fait de l’impérialisme que du colonialisme, est très intéressante. Elle nous permet de cerner un peu mieux cette Afrique fantasmée où se déplace notre héros. Si ce n’est pas exactement le Congo belge, les allusions qui y sont faites sont peut-être là pour faire resurgir l’aspect tragique de ce colonialisme imbécile. Depuis 1900, le partage du monde est à peu près achevé. Dans l’Afrique tropicale où les grandes puissances s’efforcent d’établir leurs « droits » par des traités conclus et non tenus avec des chefs et des souverains locaux, où le roi des Belges a passé des accords secrets avec Stanley pour qu’il lui taille une colonie privée, où la conférence de Berlin (1884-1885) a posé les règles générales présidant au partage des territoires encore disponibles en Afrique et la poudre aux yeux qui va avec, tout est possible. Les prétextes « humanitaires » et paternalistes, alors hautement déclarés, comme l’interdiction de l’esclavage, la répression de la traite, des mesures contre le trafic des armes et de l’alcool, etc., ne tinrent pas. Les Africains sont donc réduits de fait à un esclavage généralisé, soumis à des exactions pire que celles auxquelles donnait lieu l’esclavage traditionnel ; leurs droits et leurs États se trouvent supprimés et les autochtones réduits à n’être plus que des « sujets » coloniaux d’une métropole européenne. Pour revenir à Tarzan, ou plus précisément à ERB, on peut imaginer que ces centaines d’Africains fuyant « l’oppresseur blanc » dont il parle, poursuivis par une colonne de militaires, essayaient d’échapper aux effets désastreux de la politique de décrets de Léopold II, dont un qui décide que les terres « vacantes » appartiennent à l’État. Il en est de même pour les terrains de chasse, de culture non occupés (ce qui est la majorité des terres de culture en Afrique ou le système agricole prévoit de longues périodes où les terres sont laissées en repos), sont déclarés « propriété de l’État ». Décret suivit d’autres décrets comme celui du 21 septembre 1891 qui réserve à l’État le « produit » des terres domaniales, surtout des ivoires et du caoutchouc. Ce à quoi il faut ajouter l’institution légale du « travail forcé », de l’esclavage patriarcal africain, des « camps d’otages » où sont enfermés et affamés femmes et enfants, de la chasse à l’homme en brousse, des mains coupées aux fugitifs, bref de tout ce que produisit cette atroce période du « caoutchouc rouge » dont furent victimes des milliers, sinon des millions d’Africains[1]. Colonie et coloniaux que n’hésite pas à mettre en scène Burroughs avec ses méchants trafiquants, ses militaires endimanchés et ses savants faussement éthérés, comme le professeur Porter, père de Jane, venu expertiser les richesses de l’endroit.
Quant à la résistance très honorable de ces Africains venu se cacher dans la forêt, elle est, dans le roman, immédiatement annulée par le fait qu’après leurs crimes « ils s’étaient gavés de viande humaine ».
Cette accusation de cannibalisme nous oblige à dire un mot des tentatives de l’homme-singe de « jouer les sauvages »… Nous en étions à ce moment où, à la lisière de la forêt, il attrapa au lasso l’ARCHER. Sans doute l’étrangla-t-il car il semble que lorsqu’il le « poignarda droit au coeur », il était déjà mort mais par ce geste, sa mère « Kala était vengée ». Sans plus de manières, « Tarzan avait faim [...] C’était son gibier que la loi de la jungle lui permettait de manger ». Mais Burroughs rassure le lecteur, il ne peut s’agir ici de cannibalisme pour « cet homme singe au corps et au cœur de gentilhomme anglais et à l’éducation de fauve ». Preuve en est que « jamais la pensée de dévorer Tublat ne l’avait effleuré ». L’auteur anticipe la réaction que va avoir Tarzan en posant une question faussement naïve : « Est-ce que les hommes mangeaient les hommes ? Hélas, il ne le savait pas. » La réponse fut plus forte que toute morale ou raison : « [...] Il s’apprêta à se tailler des morceaux de la chair de Kalonga. Mais une soudaine nausée le prit. Il ne comprenait plus. » Quant à notre réponse : oui, il est souvent arrivé que des hommes mangent des hommes et cela n’a pas grand-chose à voir avec les de Burroughs .
L’héritage sociobiologique
Pour l’écrivain, à défaut d’informations précises sur le cannibalisme tout en voulant se convaincre de l’impossible de la chose, le malaise de son héros est lié avant tout à une histoire de « race » autant que de science et de classe. Tarzan, fils de Lord Greystoke aurait par sa naissance hérité de cette noblesse d’âme, de corps et de sang ineffaçable et inégalable. Ce serait le fruit d’« un instinct héréditaire, transmis de génération en génération depuis des siècles, [qui] prenait le pas sur son esprit inculte et l’empêchait de transgresser une vieille loi universelle, dont il ignorait l’existence. » On sait que Burroughs fit beaucoup de recherches à la Chicago Public Library, lut Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), peut-être : Discours sur l’origine des fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755, l’Introduction à la science sociale, 1877, d’Herbert Spencer (1820-1903), l’Évolution et l’origine des espèces, 1893, de Thomas Henry Huxley (1893-1943) ; il lut également Le Déclin de l’Occident : esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, 1918-1922, livre mondialement connu du philosophe allemand Oswald Spengler (1888-1936), et il étudia bien entendu L’Origine des espèces de Charles Darwin (1809-1882). Cet ouvrage dont le titre original The Origin of Species by Means of natural Selection or the Preservation of favoured Races in struggle for Life, 1859, nous ramène plus directement à l’histoire de Tarzan.
Au milieu du xixe siècle, l’idée d’hérédité, après avoir été longtemps une notion proprement juridique (il s’agissait de la transmission des biens matériels au sein d’un lignage) a trouvé une application dans les sciences naturelles. Elle est entrée dans le domaine anatomo-physiologique et a commencé à désigner la transmission des caractères physiques par la génération.
Dans ces nouveaux travaux sur l’hérédité, deux noms émergent, celui de Charles Darwin et de Gérard Mendel ; le premier travaille sur le règne animal, le second sur le règne végétal, mais tout deux travaillent sur la domination contraignante des mécanismes héréditaires. Précisons qu’aucun d’entre eux ne se sera attaché à décrire les mécanismes de l’hérédité chez l’homme ! Or Darwin est couramment considère comme ayant travaillé sur l’homme à cause de son ouvrage The Descent of Man, infidèlement traduit par la « descendance »alors qu’il s’agit de son « ascendance », où Darwin parle des Grands Singes, de l’évolution, de la morale et de la religion, mais qui n’a pas l’importance théorique de L’Origine des espèces. Quoi qu’il en soit, Darwin occupe dans les sciences du xixe siècle une place centrale et des plus symbolique. Il est l’image d’une étape ambiguë de l’histoire des sciences modernes. Beaucoup ont cru que son raisonnement portait sur l’animal humain ou l’animal non humain, or le seul animal sur lequel il travailla réellement fut le pigeon.
C’est dans le contexte de cette époque, entre 1911 et 1940, que Burroughs écrivit ses Tarzan. Les idées eugéniques gagnaient en force aux États-Unis avec une connotation d’objectivité scientifique. Beaucoup avaient foi dans le déterminisme biologique jusqu’à le considérer comme un instrument important du progrès social et de sa réforme, dans le sens de l’ordre, qu’ils n’hésitaient pas à associer à la morale des vainqueurs. Il faudrait citer aussi ce personnage peu recommandable qu’est Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), l’auteur de l’Essai sur les inégalités des races humaines de 1855. Il avait accusé Darwin de l’avoir pillé, mais ce dernier n’a jamais reconnu comme source d’inspiration que les travaux de Malthus. Il est vrai que ces deux philosophes sociaux, Darwin, grand bourgeois anglais et Gobineau, de noble lignée , avaient de la société une vision extrêmement proche ; vision que Burroughs aussi partageait. Son éducation faite dans les valeurs strictement victoriennes d’un père tatillon sur l’ordre et la ponctualité dans sa maisonnée ne peut pas l’avoir laissé insensible à ces vues scientifiques et joua certainement dans l’invention de certains de ses personnages notamment celui de Lord Greystoke, géniteur de Tarzan.
Cette morale « si naturelle » de supériorité, l’éloge de la force, du chef, la création de la raciologie et des échelles raciales alors considérées comme une catégorie scientifique, firent des adeptes dans le monde entier, dont Burroughs . John Taliaferro[4], son biographe, montre que l’intérêt de Burroughs pour l’eugénisme continua de grandir, même quand il devint l’objet de controverse sérieuse dans la communauté scientifique. Son attachement à ce topique était tel que ERB prit position dans une colonne du Los Angeles Examiner contre cette nouvelle « morale imbécile… » et qu’il écrivit un essai, jamais publié, intitulé I See a New Race ou il livrait « sa propre solution finale au problème du monde ».
Ce qu’on a appelé le « social-darwinisme » au début du xxe siècle, qui est l’application aux rapports humains d’un schéma discerné par Darwin dans l’analyse des traits morphologiques du vivant, va jouer un rôle déterminant, en effet, dans le monde intellectuel de la période hégémonique de l’Occident. La liaison profonde entre le courant social-darwiniste du début du xxe siècle et les présupposés idéologiques du nazisme a été largement montrée et est aujourd’hui une évidence. Moins bien perçu (et connu) est la sociobiologie contemporaine qui introduit ouvertement l’homme dans la problématique de la force, de l’agression et de la survie, une idéologie qui revient et qui séduit tant le discours libéral…
On ne peut nier que les Tarzan participèrent très largement à diffuser cette idéologie raciste et à renforcer les stéréotypes. On écrivit même que Tarzan permis à l’Amérique de « réassurer la suprématie de l’homme blanc sur SES femmes et sur SES Noirs ». Au racisme qu’il servit si bien, on lui reproche en plus le sexisme, l’aventurisme et l’ultra-individualisme ; toutes vertus que supporte et entretient la mégamachine médiatique qui s’est mise en place dès sa conception. Ce « héros anglo-mâle » joua toujours sur la dimension négative des sociétés non-blanches où « les Noirs sont de façon générale superstitieux, les Arabes, rapaces et les femmes à soumettre".
Les aventures de Tarzan n’ont jamais été bien vues dans les écoles ni considérées par l’Académie comme de la littérature, à l’exacte inverse de celles de Mowgli du Livre de la jungle de Kipling (1865-1936), auteur qui obtint le prix Nobel de Littérature en 1907 et fut à l’origine d’un engouement pour l’histoire particulière de cet enfant sauvage. Mowgli fit en effet réfléchir les « civilisés » sur le thème : existe-t-il des « humains différents » dont on ignorerait l’existence, survivants dissimulés d’un stade archaïque ou anticipation d’un lointain futur ? Le nom même d’Edgar Rice Burroughs (1875-1950), en dehors d’un cercle restreint d’amateurs de science-fiction, est assez peu connu. Par contre, celui de Tarzan résonne toujours tout autour de la planète grâce à la production multimédia contemporaine. Cela n’empêcha pas Burroughs de vendre de son vivant plus de trente millions d’ouvrages publiés dans une trentaine de langues.
À l’âge de trente-six ans, l’écrivain chercha le moyen de devenir un auteur à succès. En 1911, il entama des recherches à la Chicago Public Library pour s’ouvrir de nouveaux horizons. Il découvrit In Darkest Africa de Henry Morton Stanley (1841-1904). Bien entendu The Jungle Book, 1894, de Rudyard Kipling, il lut aussi Jack London The Call of the Wild et The Sea Wolf, le premier racontant l’histoire d’un chien « civilisé » retournant à l’état sauvage, le second narrant l’aventure d’un homme sophistiqué forcé à s’adapter à la vie primitive. Il s’enticha d’un article du grand anthropologue anglais E. Burnett Tylor intitulé « Wild Men and Beast Children », 1863 et de Childhood of Fiction de J. A. MacCulloch, 1905. Il a surtout été marqué par l’histoire de Romulus et Remus et le récit de « Dan, the Monkey Man », un jeune homme qui racontait qu’il avait été adopté par un groupe de grands Singes quelque part sur la côte africaine. Enfin, comme l’éditeur Robert Hobart Davis lui proposait sept cents dollars pour qu’il écrive des nouvelles dans son magazine, Burroughs imagina :« Un enfant d’une race solide, marqué par un caractère héréditaire plein de finesse et de noblesse […], transféré dans un environnement le plus diamétralement opposé à son milieu d’origine que j’ai pu imaginer. » Nous étions en 1912, il venait d’inventer Tarzan of the Apes qui parut à Chicago chez A. C. McClurg & Company en 1914. Ses aventures coururent sur vingt-six volumes jusqu’en 1940.
L’histoire de Tarzan est donc née de l’imagination fertile de l’Américain Edgar Rice
Burroughs et du contexte historique dans lequel il la plaça ainsi que de l’époque à
laquelle il l’écrivit depuis les Etats-Unis.
Culotte, colonialisme et cannibalisme
Burrougs aprés avoir décrit l'enfance de Tarzan parmi les anthropoïdes ajoute qu'« Au fond de son petit cœur d’Anglais montait également le profond désir de couvrir sa nudité de VÊTEMENTS, car il avait appris dans ses livres d’images que tous les HOMMES en portaient, alors que les SINGES et tous les autres êtres vivants allaient nus. Donc les VÊTEMENTS devaient sans doute être un signe de grandeur, l’insigne de la supériorité de l’HOMME sur tous les autres animaux […]
Il pensait que s’il voulait devenir HOMME il fallait qu’il respecte les préceptes de ce manuel d’apprentissage qu’il étudiait si assidûment puisqu’il ne pouvait exister d’autre motif pour se couvrir de choses aussi hideuses. »
C’est à la suite d’un orage, dans le froid et l’inconfort d’une pluie battante qui glisse mieux sur des poils que sur la peau nue de Tarzan, dont il était inconsciemment fier, écrit Burroughs, « car elle prouvait son appartenance à une race puissante ». Il n’empêche que depuis son enfance, « il était constamment partagé entre le désir de rester nu, pour que tous voient la preuve de ses origines, et celui de se conformer aux usages de sa race et de revêtir ces ornements hideux et malcommodes ».
Or, cette nuit-là « dans la tête de Tarzan, une étincelle venait de jaillir : il avait compris le pourquoi des VÊTEMENTS, comme il aurait été protégé du froid et de la pluie dans la peau chaude de Sabor ! » Du même coup, il découvre ce qu’est peut-être le climat continental tempéré de ces pays éloignés qu’il a vu dans les livres et la raison réelle du besoin de vêtements pour les hommes y habitant Son obsession de se vêtir ou plutôt de revêtir une autre peau n’est pas nouvelle, Il pensa même se faire une cape royale de la peau de la lionne Sabor qu’il avait tué. Mais il dut y renoncer car « Tarzan ne connaissait rien au tannage, cela va sans dire » et la dépouille ne put servir à habiller le roi des animaux, ni l’homme en devenir.
C’est finalement une autre proie qui va lui fournir son premier vêtement, du prêt-à-porter qu’il n’aura pas besoin de tailler mais juste d’enfiler. Il s’agit d’un bipède dont il a appris à dessiner le nom HOMME, « à la peau glabre », foncée et portant un arc. Dans l’histoire, il s’agit de Kalonga, fils du roi Mbonga, grand chasseur et assassin de Kala, la mére adoptive de Tarzan. En le pistant, Tarzan découvre pour la première fois dans la forêt des empreintes de pieds nus qui ne sont pas les siennes et, d’une certaine façon, se met sur ses propres traces.
Enfin, il aperçoit « l’étrange créature [...] Il lui ressemblait tellement [...] et pourtant ses traits et sa couleur étaient différents ! » De plus il ne ressemble pas aux images qu’il a vues dans ses livres. « Tarzan ne reconnut pas tant le NOIR que l’ARCHER de ses livres d’images.
A est un Archer...C’était merveilleux ! »
La découverte d’un autre soi-même l’enthousiasme au point que, oubliant un temps sa vengeance contre l’assassin de sa mère adoptive, il observe son premier semblable avec passion. Avec lui, il découvre la domestication du feu et la première « espèce cuisinière » doublée de l’idée sans doute réservée aux humains de profusion ou de gâchis puisque, « son estomac bien rempli, [...] il abandonna le reste sur le sol. » Tarzan se sent moins bête que lui, descend de son arbre et en animal consciencieux et prévoyant : « Il dévora sa viande crue et enfouit les restes de Horta (le sanglier) sous le sol pour les retrouver à son retour. »
Ce n’est que plus tard que Tarzan le capture au lasso. En chasseur consciencieux « Tarzan acheva silencieusement sa victime. Puis il la dépouilla de ses armes et de ses ornements et, oh joie ! d’une magnifique culotte de daim qu’il enfila immédiatement. »
Tarzan « culotté » et, de ce fait, encore un peu plus homme, s’enhardit :
« Jetant le corps sur son épaule, il se dirigea lentement vers le village... »
Il s’agit bien de « corps » et non de « proie ». Sa victime déculottée va passer au statut de « cadavre » humain et jouer son rôle à part entière dans la dernière frasque de Tarzan pour « terroriser les Noirs ». Content de son astuce et quelque peu grisé par la possession d’un vêtement, Tarzan pense « comme il aurait aimé retourner dans sa tribu et se pavaner sous les regards envieux des singes ». Il n’empêche que : « Maintenant il était vraiment habillé comme doit l’être un homme, et personne ne pouvait plus douter de sa haute naissance. »
L’histoire est pourtant plus complexe que cela. L’homme qu’il a tué et dépouillé de sa culotte appartient à une humanité coloniale et chrétienne. Cette culotte est empruntée à un Africain rhabillé par la colonisation et la chrétienté au nom de la civilisation et de la pudeur, quoi qu’il semble qu’il s’agisse plutôt ici d’un pagne traditionnel en daim et non de coton. Qu’importe, la culotte de ce Noir appartenait, précise Burroughs, a un groupe de plusieurs centaines de réfugiés ou plutôt de résistants a l’oppression coloniale. « La genèse de leur fuite commençait le jour où, excédés d’avoir à fournir toujours plus de caoutchouc et d’ivoire à l’oppresseur blanc, ils s’étaient soulevés et avaient massacré un officier européen [Crime de lèse majesté !] et le détachement de troupes indigènes qu’il commandait [Crime plus pardonnable et secondaire]. »
Le contexte colonial des « Tarzan » comme dans toute l’œuvre de Burroughs n’est pas négligeable et, d’une certaine façon sa dénonciation, retenue mais présente, par un Américain moderne plus au fait de l’impérialisme que du colonialisme, est très intéressante. Elle nous permet de cerner un peu mieux cette Afrique fantasmée où se déplace notre héros. Si ce n’est pas exactement le Congo belge, les allusions qui y sont faites sont peut-être là pour faire resurgir l’aspect tragique de ce colonialisme imbécile. Depuis 1900, le partage du monde est à peu près achevé. Dans l’Afrique tropicale où les grandes puissances s’efforcent d’établir leurs « droits » par des traités conclus et non tenus avec des chefs et des souverains locaux, où le roi des Belges a passé des accords secrets avec Stanley pour qu’il lui taille une colonie privée, où la conférence de Berlin (1884-1885) a posé les règles générales présidant au partage des territoires encore disponibles en Afrique et la poudre aux yeux qui va avec, tout est possible. Les prétextes « humanitaires » et paternalistes, alors hautement déclarés, comme l’interdiction de l’esclavage, la répression de la traite, des mesures contre le trafic des armes et de l’alcool, etc., ne tinrent pas. Les Africains sont donc réduits de fait à un esclavage généralisé, soumis à des exactions pire que celles auxquelles donnait lieu l’esclavage traditionnel ; leurs droits et leurs États se trouvent supprimés et les autochtones réduits à n’être plus que des « sujets » coloniaux d’une métropole européenne. Pour revenir à Tarzan, ou plus précisément à ERB, on peut imaginer que ces centaines d’Africains fuyant « l’oppresseur blanc » dont il parle, poursuivis par une colonne de militaires, essayaient d’échapper aux effets désastreux de la politique de décrets de Léopold II, dont un qui décide que les terres « vacantes » appartiennent à l’État. Il en est de même pour les terrains de chasse, de culture non occupés (ce qui est la majorité des terres de culture en Afrique ou le système agricole prévoit de longues périodes où les terres sont laissées en repos), sont déclarés « propriété de l’État ». Décret suivit d’autres décrets comme celui du 21 septembre 1891 qui réserve à l’État le « produit » des terres domaniales, surtout des ivoires et du caoutchouc. Ce à quoi il faut ajouter l’institution légale du « travail forcé », de l’esclavage patriarcal africain, des « camps d’otages » où sont enfermés et affamés femmes et enfants, de la chasse à l’homme en brousse, des mains coupées aux fugitifs, bref de tout ce que produisit cette atroce période du « caoutchouc rouge » dont furent victimes des milliers, sinon des millions d’Africains[1]. Colonie et coloniaux que n’hésite pas à mettre en scène Burroughs avec ses méchants trafiquants, ses militaires endimanchés et ses savants faussement éthérés, comme le professeur Porter, père de Jane, venu expertiser les richesses de l’endroit.
Quant à la résistance très honorable de ces Africains venu se cacher dans la forêt, elle est, dans le roman, immédiatement annulée par le fait qu’après leurs crimes « ils s’étaient gavés de viande humaine ».
Cette accusation de cannibalisme nous oblige à dire un mot des tentatives de l’homme-singe de « jouer les sauvages »… Nous en étions à ce moment où, à la lisière de la forêt, il attrapa au lasso l’ARCHER. Sans doute l’étrangla-t-il car il semble que lorsqu’il le « poignarda droit au coeur », il était déjà mort mais par ce geste, sa mère « Kala était vengée ». Sans plus de manières, « Tarzan avait faim [...] C’était son gibier que la loi de la jungle lui permettait de manger ». Mais Burroughs rassure le lecteur, il ne peut s’agir ici de cannibalisme pour « cet homme singe au corps et au cœur de gentilhomme anglais et à l’éducation de fauve ». Preuve en est que « jamais la pensée de dévorer Tublat ne l’avait effleuré ». L’auteur anticipe la réaction que va avoir Tarzan en posant une question faussement naïve : « Est-ce que les hommes mangeaient les hommes ? Hélas, il ne le savait pas. » La réponse fut plus forte que toute morale ou raison : « [...] Il s’apprêta à se tailler des morceaux de la chair de Kalonga. Mais une soudaine nausée le prit. Il ne comprenait plus. » Quant à notre réponse : oui, il est souvent arrivé que des hommes mangent des hommes et cela n’a pas grand-chose à voir avec les de Burroughs .
L’héritage sociobiologique
Pour l’écrivain, à défaut d’informations précises sur le cannibalisme tout en voulant se convaincre de l’impossible de la chose, le malaise de son héros est lié avant tout à une histoire de « race » autant que de science et de classe. Tarzan, fils de Lord Greystoke aurait par sa naissance hérité de cette noblesse d’âme, de corps et de sang ineffaçable et inégalable. Ce serait le fruit d’« un instinct héréditaire, transmis de génération en génération depuis des siècles, [qui] prenait le pas sur son esprit inculte et l’empêchait de transgresser une vieille loi universelle, dont il ignorait l’existence. » On sait que Burroughs fit beaucoup de recherches à la Chicago Public Library, lut Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), peut-être : Discours sur l’origine des fondements de l’inégalité parmi les hommes, 1755, l’Introduction à la science sociale, 1877, d’Herbert Spencer (1820-1903), l’Évolution et l’origine des espèces, 1893, de Thomas Henry Huxley (1893-1943) ; il lut également Le Déclin de l’Occident : esquisse d’une morphologie de l’histoire universelle, 1918-1922, livre mondialement connu du philosophe allemand Oswald Spengler (1888-1936), et il étudia bien entendu L’Origine des espèces de Charles Darwin (1809-1882). Cet ouvrage dont le titre original The Origin of Species by Means of natural Selection or the Preservation of favoured Races in struggle for Life, 1859, nous ramène plus directement à l’histoire de Tarzan.
Au milieu du xixe siècle, l’idée d’hérédité, après avoir été longtemps une notion proprement juridique (il s’agissait de la transmission des biens matériels au sein d’un lignage) a trouvé une application dans les sciences naturelles. Elle est entrée dans le domaine anatomo-physiologique et a commencé à désigner la transmission des caractères physiques par la génération.
Dans ces nouveaux travaux sur l’hérédité, deux noms émergent, celui de Charles Darwin et de Gérard Mendel ; le premier travaille sur le règne animal, le second sur le règne végétal, mais tout deux travaillent sur la domination contraignante des mécanismes héréditaires. Précisons qu’aucun d’entre eux ne se sera attaché à décrire les mécanismes de l’hérédité chez l’homme ! Or Darwin est couramment considère comme ayant travaillé sur l’homme à cause de son ouvrage The Descent of Man, infidèlement traduit par la « descendance »alors qu’il s’agit de son « ascendance », où Darwin parle des Grands Singes, de l’évolution, de la morale et de la religion, mais qui n’a pas l’importance théorique de L’Origine des espèces. Quoi qu’il en soit, Darwin occupe dans les sciences du xixe siècle une place centrale et des plus symbolique. Il est l’image d’une étape ambiguë de l’histoire des sciences modernes. Beaucoup ont cru que son raisonnement portait sur l’animal humain ou l’animal non humain, or le seul animal sur lequel il travailla réellement fut le pigeon.
C’est dans le contexte de cette époque, entre 1911 et 1940, que Burroughs écrivit ses Tarzan. Les idées eugéniques gagnaient en force aux États-Unis avec une connotation d’objectivité scientifique. Beaucoup avaient foi dans le déterminisme biologique jusqu’à le considérer comme un instrument important du progrès social et de sa réforme, dans le sens de l’ordre, qu’ils n’hésitaient pas à associer à la morale des vainqueurs. Il faudrait citer aussi ce personnage peu recommandable qu’est Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882), l’auteur de l’Essai sur les inégalités des races humaines de 1855. Il avait accusé Darwin de l’avoir pillé, mais ce dernier n’a jamais reconnu comme source d’inspiration que les travaux de Malthus. Il est vrai que ces deux philosophes sociaux, Darwin, grand bourgeois anglais et Gobineau, de noble lignée , avaient de la société une vision extrêmement proche ; vision que Burroughs aussi partageait. Son éducation faite dans les valeurs strictement victoriennes d’un père tatillon sur l’ordre et la ponctualité dans sa maisonnée ne peut pas l’avoir laissé insensible à ces vues scientifiques et joua certainement dans l’invention de certains de ses personnages notamment celui de Lord Greystoke, géniteur de Tarzan.
Cette morale « si naturelle » de supériorité, l’éloge de la force, du chef, la création de la raciologie et des échelles raciales alors considérées comme une catégorie scientifique, firent des adeptes dans le monde entier, dont Burroughs . John Taliaferro[4], son biographe, montre que l’intérêt de Burroughs pour l’eugénisme continua de grandir, même quand il devint l’objet de controverse sérieuse dans la communauté scientifique. Son attachement à ce topique était tel que ERB prit position dans une colonne du Los Angeles Examiner contre cette nouvelle « morale imbécile… » et qu’il écrivit un essai, jamais publié, intitulé I See a New Race ou il livrait « sa propre solution finale au problème du monde ».
Ce qu’on a appelé le « social-darwinisme » au début du xxe siècle, qui est l’application aux rapports humains d’un schéma discerné par Darwin dans l’analyse des traits morphologiques du vivant, va jouer un rôle déterminant, en effet, dans le monde intellectuel de la période hégémonique de l’Occident. La liaison profonde entre le courant social-darwiniste du début du xxe siècle et les présupposés idéologiques du nazisme a été largement montrée et est aujourd’hui une évidence. Moins bien perçu (et connu) est la sociobiologie contemporaine qui introduit ouvertement l’homme dans la problématique de la force, de l’agression et de la survie, une idéologie qui revient et qui séduit tant le discours libéral…
On ne peut nier que les Tarzan participèrent très largement à diffuser cette idéologie raciste et à renforcer les stéréotypes. On écrivit même que Tarzan permis à l’Amérique de « réassurer la suprématie de l’homme blanc sur SES femmes et sur SES Noirs ». Au racisme qu’il servit si bien, on lui reproche en plus le sexisme, l’aventurisme et l’ultra-individualisme ; toutes vertus que supporte et entretient la mégamachine médiatique qui s’est mise en place dès sa conception. Ce « héros anglo-mâle » joua toujours sur la dimension négative des sociétés non-blanches où « les Noirs sont de façon générale superstitieux, les Arabes, rapaces et les femmes à soumettre".
jeudi 21 mai 2009
cybernétique: du marketing au prosélytisme

EN ROUTE VERS LE POSTHUMAIN
Cybernétique, du marketing au prosélytisme
A nouvelles technologies, nouveaux usages. Le développement récent des TIC- Techniques de l’Information et de la Communication- dés le début des années 1980 , années où l’on a surtout commencé à étudier la formation des usages des premiers outils , à permis de se rende compte d’une chose importante, à savoir que les outils ne suivaient pas les prescriptions des
« offreurs » ( nouveau terme pour dire « marchands ») et surtout que les usages réels de ces outils proposés étaient loin de correspondre à ce qu’on imaginait ; a ce que peut-être les « concepteurs purs » , les inventeurs, avaient imaginés. Ce qu’il faut retenir de cette période est le fait que les producteurs de ces outils ont, au début, été assez désorientés par les réactions imprévues des nouveaux consommateurs. C’est la raison pour laquelle ils se sont très vite tournés vers les spécialistes du marketing afin d’essayer de comprendre comment réagissaient les usagers et surtout comment s’installaient les usages de ce que l’on a commencé à appeler les « produits communicationnels ». Ils ont pour cela fait appel à des chercheurs qui devaient regarder comment s’opérait le processus d’insertion des TIC dans la société, une société qui devint alors de plus en plus au centre des préoccupations des chercheurs.
L’industrie de la communication a commencé à analyser comment l’on pouvait passer de l’
« innovateur » aux « adopteurs », plus particulièrement aux « adopteurs précoces » . Je passe ici sur les modèles d’étude de diffusion (information, persuasion, décision, application et confirmation) auxquels correspondent des « groupes d’acteurs » dans lesquels, par ordre, on retrouvera les adopteurs précoces, la majorité précoce, la majorité tardive et les retardataires dont je suis … Ainsi donc, grâce aux « innovateurs -traducteurs » la recherche scientifique est sortie des laboratoires pour entrer dans nos bureaux.
Je pense ici à Norbert Wiener , qui des 1947 inventait la cybernétique , dont on a une idée assez compléte dans son passionnant ouvrage « Cybernetics or control and communication in the Animal and the Machine » publié en 1947 et aux hyppies de Berkeley qui dans les années 1970 voyaient dans le micro-ordinateur la possibilité d’un raccourci du travail pour pouvoir paresser plus longtemps c'est-à-dire vivre pleinement sa vie… Ces choses là existent bel et bien mais leur utilisation ne s’est pas cantonné à ce qu’on avait imaginé, hélas. Dés les premiers temps de la bureautique, ce moment où on a commencé à s’équiper de systèmes d’information qu’on nous a présenté comme des nouveautés d’ailleurs purement techniques, « on » s’est rendu compte que la productivité pouvait augmenter et avec elle la charge de travail – En les utilisant nous remplissions des tâches nouvelles sans le savoir, cela progressivement et a notre dépens.
L’introduction de nouveaux TIC, le prestige et le pouvoir que cela procurait aux quelques utilisateurs avertis entraîna très vite une stratégie de recomposition socio-organisationnelle du travail. Aux TIC allaient bientôt s’adjoindre le stress et ses TOCs , nouveaux maux du siècle commençant. Bien entendu les « retardataires » traînaient des pieds, mais pendant ce temps l’industrialisation de l’information et de la culture avançaient avec le développement exponentiel d’une production industrielle et internationalisée telle que nous la connaissons aujourd’hui. Des industries triples et solidaires alliant une industrie du contenu, des industries de matériels et de logiciels et une industrie des réseaux qu’on appelle aussi les opérateurs de télécommunications, s’imposèrent en masse sur le marché. Je laisse de côté le marigot où les multinationales se sont amusées et s’amusent encore au jeu des fusions et autres confusions dont on peu voir les résultats aujourd’hui .Bref cette prise de pouvoir dans notre vie professionnelle et privée des TIC nous a lentement fait rentrer dans une nouvelle espace et une nouvelle temporalité annoncée : le cyberespace ; un espace inventé qui nous ouvre l’accès au service universel et à la connaissance à travers mille bouquets numériques qui devant nos yeux s’épanouissent.
Le cyberespace est un bien un espace autre, quelque chose qui se propose de substituer l’espace prédonné par un espace de données , ainsi que de virtualiser et d’idéaliser l’étendue terrestre comme le remarque très justement Antonio Casilli dans son article « Posthumani nihil a me alienum puto », Le discours de l’hospitalité dans la cyberculture » ( Revue Sociétés, n° 83, 2004/ 1) . Norbert Wiener l’avait annoncé dans « cybernétique et société », ( éditions des Deux Rives », 1949, p 149) . Il y notait, « certes il nous faudra modifier maints détails de notre façon de vivre lorsque nous entrerons en rapport avec les machines nouvelles. » En effet le voyageur du cyberespace est un voyageur qui se déplace sur un territoire fluide dans un but précis: celui de collecter de l’information et peut-être même , c’est en tout cas ce qui lui est promis et c’est pour cela qu’il est là assis devant sa Toile, d’augmenter ses connaissances . On notera que la cyberculture a engendrée elle aussi, un certain nombre de symptômes linguistiques et de mots nouveaux liés à la navigation. Qu’est-ce qu’un cyber-naute si non un navigateur , mais un navigateur d’un type nouveau , sachant , comme l’a écrit Wiener que « les organes du gouvernail d’un navire sont en fait une des formes les plus précoces et les mieux développées des mécanismes d’action en retour . » (Wiener , 1949, p 286)
Le cybernaute est un navigateur pressé, il va vite, très vite parce qu’il faut aller vite et sans appuie, sans coquille lourde comme un bateau appareillé, il va même se transformer en « surfeur » dans ces méandres inattendus de la masse de données. Savoir naviguer sur la Toile, c’est savoir où chercher et comment repérer une ou des informations et très vite développer des « cartographies cognitives » du territoire fluide de connaissance, jusqu'à devenir un véritable expert en ses lubies passagères. Le cybernaute se fait aussi nomade de la frontière numérique. Dans ce nouveau ciel entoilé on lui assure qu’il va rejoindre une communauté virtuelle et peut-être même adhérer avec elle au « culte Internet ». IL s’agit d’une métaphore bien évidemment mais aussi, comme le remarque Philippe Breton dans « Le culte d’Internet, une menace pour le lien social ?( La découverte , Paris, 2000), de liens forts avec une machine associée à des pratiques très particulières et a ce qu’elle ouvre dans la vie. Philippe Quéau dans « La planète des esprits » ( Odile Jacob, 200O), parle même d’un nouveau Luther. A propos de ces nouveaux religieux de la Toile on a l’exemple caricatural mais loin d’être isolé de ces internautes qui se mettent à vivre au su et au vu de tous en installant chez eux des caméras . Ceci est a lire comme un bel exemple de luthéranisme en effet. Ils veulent dire : nous n’avons rien à cacher, nous avons même une attitude morale, la preuve : la camera montre tout ce que nous faisons. Je parle de Luther, mais n’oublions pas Teilhard de Chardin, ce jésuite qui inventa la notion de noosphére , notion qui est aux idées ce que la biosphère est à la vie. Selon lui, ce sont les nouvelles technologies de communication qui permettront à l’avenir de franchir une nouvelle étape dans l’évolution de l’humanité. Des nouvelles technologies qui devraient nous soulager, nous permettrent de détacher les esprits de la matérialité et de les « collectiviser ». Ces thèmes de la société de la communication et de la noosphére n’ont cessé de gagner en influence au sein de la société, ceci pour une bonne raison, c’est que dans une société marquée par la crise du lien social, la promesse de plus de communication et de convivialité ne peut recevoir qu’un écho favorable. J’ajouterai que depuis la fondation de la cybernétique, on trouve que l’idée de communication est une valeur positive, que développée elle peut permettre de lutter contre le désordre et l’entropie tels que les générations de la seconde guerre mondiale qui pour Wiener n’incarnait pas autre chose que « le mal et le diable… » . C’est donc bien le futur des années 1940 qui nous est aujourd’hui proposé avec Internet. En tout cas le cybernaut contemporain, sa religion et son prosélytisme technophile, largement alimenté par les marchands, nous assure qu’Internet transforme notre existence. Et effectivement Internet a complètement chamboulé notre existence au point qu’il nous faut reconnaître que le virtuel a pris le pouvoir sur notre quotidien.
(à suivre)
Je pense ici à Norbert Wiener , qui des 1947 inventait la cybernétique , dont on a une idée assez compléte dans son passionnant ouvrage « Cybernetics or control and communication in the Animal and the Machine » publié en 1947 et aux hyppies de Berkeley qui dans les années 1970 voyaient dans le micro-ordinateur la possibilité d’un raccourci du travail pour pouvoir paresser plus longtemps c'est-à-dire vivre pleinement sa vie… Ces choses là existent bel et bien mais leur utilisation ne s’est pas cantonné à ce qu’on avait imaginé, hélas. Dés les premiers temps de la bureautique, ce moment où on a commencé à s’équiper de systèmes d’information qu’on nous a présenté comme des nouveautés d’ailleurs purement techniques, « on » s’est rendu compte que la productivité pouvait augmenter et avec elle la charge de travail – En les utilisant nous remplissions des tâches nouvelles sans le savoir, cela progressivement et a notre dépens.
L’introduction de nouveaux TIC, le prestige et le pouvoir que cela procurait aux quelques utilisateurs avertis entraîna très vite une stratégie de recomposition socio-organisationnelle du travail. Aux TIC allaient bientôt s’adjoindre le stress et ses TOCs , nouveaux maux du siècle commençant. Bien entendu les « retardataires » traînaient des pieds, mais pendant ce temps l’industrialisation de l’information et de la culture avançaient avec le développement exponentiel d’une production industrielle et internationalisée telle que nous la connaissons aujourd’hui. Des industries triples et solidaires alliant une industrie du contenu, des industries de matériels et de logiciels et une industrie des réseaux qu’on appelle aussi les opérateurs de télécommunications, s’imposèrent en masse sur le marché. Je laisse de côté le marigot où les multinationales se sont amusées et s’amusent encore au jeu des fusions et autres confusions dont on peu voir les résultats aujourd’hui .Bref cette prise de pouvoir dans notre vie professionnelle et privée des TIC nous a lentement fait rentrer dans une nouvelle espace et une nouvelle temporalité annoncée : le cyberespace ; un espace inventé qui nous ouvre l’accès au service universel et à la connaissance à travers mille bouquets numériques qui devant nos yeux s’épanouissent.
Le cyberespace est un bien un espace autre, quelque chose qui se propose de substituer l’espace prédonné par un espace de données , ainsi que de virtualiser et d’idéaliser l’étendue terrestre comme le remarque très justement Antonio Casilli dans son article « Posthumani nihil a me alienum puto », Le discours de l’hospitalité dans la cyberculture » ( Revue Sociétés, n° 83, 2004/ 1) . Norbert Wiener l’avait annoncé dans « cybernétique et société », ( éditions des Deux Rives », 1949, p 149) . Il y notait, « certes il nous faudra modifier maints détails de notre façon de vivre lorsque nous entrerons en rapport avec les machines nouvelles. » En effet le voyageur du cyberespace est un voyageur qui se déplace sur un territoire fluide dans un but précis: celui de collecter de l’information et peut-être même , c’est en tout cas ce qui lui est promis et c’est pour cela qu’il est là assis devant sa Toile, d’augmenter ses connaissances . On notera que la cyberculture a engendrée elle aussi, un certain nombre de symptômes linguistiques et de mots nouveaux liés à la navigation. Qu’est-ce qu’un cyber-naute si non un navigateur , mais un navigateur d’un type nouveau , sachant , comme l’a écrit Wiener que « les organes du gouvernail d’un navire sont en fait une des formes les plus précoces et les mieux développées des mécanismes d’action en retour . » (Wiener , 1949, p 286)
Le cybernaute est un navigateur pressé, il va vite, très vite parce qu’il faut aller vite et sans appuie, sans coquille lourde comme un bateau appareillé, il va même se transformer en « surfeur » dans ces méandres inattendus de la masse de données. Savoir naviguer sur la Toile, c’est savoir où chercher et comment repérer une ou des informations et très vite développer des « cartographies cognitives » du territoire fluide de connaissance, jusqu'à devenir un véritable expert en ses lubies passagères. Le cybernaute se fait aussi nomade de la frontière numérique. Dans ce nouveau ciel entoilé on lui assure qu’il va rejoindre une communauté virtuelle et peut-être même adhérer avec elle au « culte Internet ». IL s’agit d’une métaphore bien évidemment mais aussi, comme le remarque Philippe Breton dans « Le culte d’Internet, une menace pour le lien social ?( La découverte , Paris, 2000), de liens forts avec une machine associée à des pratiques très particulières et a ce qu’elle ouvre dans la vie. Philippe Quéau dans « La planète des esprits » ( Odile Jacob, 200O), parle même d’un nouveau Luther. A propos de ces nouveaux religieux de la Toile on a l’exemple caricatural mais loin d’être isolé de ces internautes qui se mettent à vivre au su et au vu de tous en installant chez eux des caméras . Ceci est a lire comme un bel exemple de luthéranisme en effet. Ils veulent dire : nous n’avons rien à cacher, nous avons même une attitude morale, la preuve : la camera montre tout ce que nous faisons. Je parle de Luther, mais n’oublions pas Teilhard de Chardin, ce jésuite qui inventa la notion de noosphére , notion qui est aux idées ce que la biosphère est à la vie. Selon lui, ce sont les nouvelles technologies de communication qui permettront à l’avenir de franchir une nouvelle étape dans l’évolution de l’humanité. Des nouvelles technologies qui devraient nous soulager, nous permettrent de détacher les esprits de la matérialité et de les « collectiviser ». Ces thèmes de la société de la communication et de la noosphére n’ont cessé de gagner en influence au sein de la société, ceci pour une bonne raison, c’est que dans une société marquée par la crise du lien social, la promesse de plus de communication et de convivialité ne peut recevoir qu’un écho favorable. J’ajouterai que depuis la fondation de la cybernétique, on trouve que l’idée de communication est une valeur positive, que développée elle peut permettre de lutter contre le désordre et l’entropie tels que les générations de la seconde guerre mondiale qui pour Wiener n’incarnait pas autre chose que « le mal et le diable… » . C’est donc bien le futur des années 1940 qui nous est aujourd’hui proposé avec Internet. En tout cas le cybernaut contemporain, sa religion et son prosélytisme technophile, largement alimenté par les marchands, nous assure qu’Internet transforme notre existence. Et effectivement Internet a complètement chamboulé notre existence au point qu’il nous faut reconnaître que le virtuel a pris le pouvoir sur notre quotidien.
(à suivre)
Inscription à :
Commentaires (Atom)