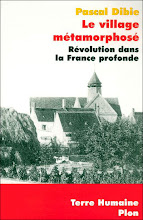Où aller chercher ma vocation ? Peut-être dans le fait que je suis le quatrième d’une fratrie et que pour exister il m’a fallu me construire un univers où j’aurais ma place…Oui, c’est peut-être en m’identifiant aux enfants du village et en m’enracinant concrètement dans la culture rurale que j’ai développé une double culture, rurale et citadine, et qu’est né ce goût, sinon de l’ailleurs, au moins de l’autre. Il serait difficile de nier que mon travail est en liaison plus ou moins directe avec mon enfance, plus précisément la topologie de mes lieux d’enfance. En effet que ce soit mon village en Bourgogne, la rue du regard où j’habitai à Paris ou des lieux plus intimes comme la chambre à coucher que j’ai dû garder longtemps à une époque pour cause d’une longue maladie, tous ces lieux ont sûrement déterminé une part de ma recherche. Pour revenir à ma vocation d’ethnologue. Après une scolarité très atypique, le bac enfin en poche, j’ai fait une tentative d’étude en droit, assez vite avortée, en même temps que je m’inscrivais en histoire à la Sorbonne. Là, j’ai été frappé par un certain nombre de figures comme Jules Michelet (1798-1874), par exemple, qui proposait pour voir et relire notre histoire d’utiliser la production de l’historien comme une sorte d’action et surtout l’abordait sous un angle charnel en proposant de ne jamais se défaire de sa sensibilité pour regarder l’homme passé et présent. En fait, il proposait déjà de faire une sorte d’anthropologie historique et pour reprendre Roland Barthes qui, plus que mes professeurs, m’avait poussé dans les bras de Michelet : « en ne lisant pas Michelet, c’est notre désir que nous censurons ». Derrière cet historien, dont il ne faut pas oublier qu’il avait été suspendu de sa chaire au collège de France après le coup d’état du 2 décembre 1851, c’est du côté de Philippe Ariès (1914-1984), de Leroy-Ladurie et d’autres enseignants convaincus de l’importance de l’histoire des mentalités que j’allais fouiner. L’Histoire des mentalités était déjà largement en germe dans l’école historique française qui depuis Lucien Febvre s’exprimait à travers la fameuse revue des « Annales » que je dévorais ardemment. On comprendra que ma Maîtrise d’histoire en poche, j’étais mûr pour l’ethnologie. D’autant que, faisant en même temps du Chinois aux Langues’O, j’ai fait mon mémoire sur « le Docteur Legendre et la pénétration Française en Chine méridionale » et mon C2, certificat de spécialisation, sur l’histoire de l’Asie du Sud-est sous la direction de Jean Chesneaux. Le pas vers l’ethnologie était presque franchi. C’est en accompagnant un ami s’inscrire en environnement à la faculté de Jussieu à la rentrée universitaire 1971-1972 - les cloisons n’étaient pas encore montées -, que je vois collé sur l’une des tables le mot « ethnologie » … Et là, je me suis dit : « c’est toujours ça que j’ai voulu faire ; je veux être ethnologue ». Sans faillir, puisque j’avais une Maîtrise, je me suis inscrit en doctorat le jour même. J’étais également agrégatif d’histoire, mais, en deux ans, mes velléités d’être prof d’histoire m’ont paru bien pâles à côté de cette incroyable passion qui s’installait en moi : faire de l’ethnologie, devenir ethnologue !
En 1972, je rentre donc en ethnologie à Jussieu et je découvre que c’est tout à fait autre chose que ce que j’avais imaginé. J’avais bien sûr lu « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, mais pour moi l’ethnologie était assimilée au voyage, à la découverte exploratoire plus qu’à la philosophie ; je ne savais pas que la discipline posait aussi des questions éthiques : l’Occident, l’autre, la question de l’ethnocide… Je découvrais une discipline complexe qui imposait que l’on passe par l’ethnographie, puis l’ethnologie avant d’arriver à des choses plus profondes et surtout aux champs incroyablement vastes de l’anthropologie. En fin de compte, je commençais une aventure savante, une sorte de quête à la connaissance qui est bien loin d’être terminée aujourd’hui.
Ce qui m’a plu tout de suite ce sont les cours d’ethnologie du monde moderne, qui me permettaient d’utiliser ma formation rigoureuse d’historien tout en étant dans des préoccupations présentes. Au sortir de 68, l’ambiance intellectuelle était à la contestation et à la critique radicale des disciplines elle-même. Ma génération s’inscrivait naturellement dans ce type de questionnement autour du désir de « vivre ici et maintenant ». Je me souviens, sur le tableau de notre salle à Jussieu, était inscrit à la peinture indélébile : « on n’arrête pas le printemps »... Et je n’ai jamais arrêté le printemps.
Je crois que l’ethnologie faisait et fait toujours partie de cette fête d’été sans fin. Cela a été l’entrée dans une vie trépidante pleine de rencontres, de voyages en Amérique du Sud et du Nord , en Laponie en Bourgogne , etc. Des rencontres autant avec des poètes que des savants – pour moi à l’époque nos professeurs en étaient indubitablement – et de passions intellectuelles sur lesquelles je reviendrai. Autre chose importante, ce département d’ethnologie à Jussieu avait commencé de façon pirate en opposition à l’ethnologie structuraliste de Lévi Strauss, qui était enseigné à l’EHESS et surtout à Nanterre.… À l’époque, on se définissait à travers des appartenances à des écoles. La polémique était possible et même recherchée. On n’était pas dans la censure mais dans une poussée de vie. Moi je m’y suis trouvé très bien. J’y ai rencontré des enseignants comme Robert Jaulin (cf La Paix Blanche, Seuil, 1972), Pierre Bernard, Serge Moscovici (La société contre nature, UGE), Jean Monod (Riche Cannibales, UGE, 1972), Michel Panoff (L’ethnologue et son double, Payot, 1977), Pierre Clastres (La société contre l’état, Seuil, 1972), Jacques Meunier (Le chant du Silbaco, Payot, 1972), Jean Malaurie (Les derniers rois de Thulé, Terre humaine / Plon, 1955), etc. Ceux-ci animaient des « cours pirates », nous donnaient une liberté de parole et de pensée toute nouvelle et bien peu académique parce qu’ils n’étaient pas bloqués dans l’institution, même si le département est devenu officiellement une UFR de l’Université Paris 7 l’année où j’y suis entré. C’était un lieu ouvert où l’on vivait littéralement ensemble. On allait chez nos professeurs, ils venaient chez nous, on partait même parfois sur le terrain ensemble, bref, c’était une véritable aventure intellectuelle communautaire et quelque peu libertaire, enthousiasmante évidemment pour un jeune étudiant. Toujours est-il que je découvrais l’ethnologie à ce moment charnière où se posait la question de l’existence même de l’ethnologie en termes éthiques, où l’occident se mettait en question, revenait sur son histoire, ses manières d’être à l’autre – je pense à la question de l’ethnocide, cette façon insidieuse de détruire la culture de l’autre – et où nous repensions l’anthropologie à partir du monde moderne et de son avenir.
Un des points fort de l’enseignement et des actions que nous menions à partir de l’UFR fut l’écologie ; je dirais plus précisément l’écologie politique que nous inventions ensemble et qui, il faut bien le reconnaître, reste la seule innovation qui ait profondément et pour une longue période je le crains - car il s’agit de l’état de notre planète -, irrigué notre forme de vie actuelle et, petit à petit, toute la culture politique contemporaine. Enfin, rapidement initié à cette ethnologie en rupture, en 1975, je passais ma thèse de IIIe cycle en ethnologie sur les frontières, désormais bien minces, qui séparaient l’histoire de l’ethnologie. En 1987, j’étais élu Maître de conférence dans le département d’ethnologie de l’Université Paris 7 dont j’assurerai la direction à la suite de Robert Jaulin de 1990 à 1996. Durant cette période, je soutenais enfin mon doctorat d’état en 1992, qui me donnait de facto l’habilitation à diriger des Thèses, HDR. Je fondais également avec l’ethnologue-cinéaste Jean Arlaud, le Laboratoire d’Anthropologie Visuelle et sonore du Monde Contemporain. En 2004 je me retrouve dans le département des Sciences Sociales, l’Université de Paris 7 ayant jugée bon de dissoudre l’UF AESR et le LAVSMC estimant que l’ethnologie avait assez vécu en ses murs alors que jamais dans notre société en mutation, les questions anthropologiques ne se sont posées de façon aussi cruciale. Que comprendre ?
En 1972, je rentre donc en ethnologie à Jussieu et je découvre que c’est tout à fait autre chose que ce que j’avais imaginé. J’avais bien sûr lu « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss, mais pour moi l’ethnologie était assimilée au voyage, à la découverte exploratoire plus qu’à la philosophie ; je ne savais pas que la discipline posait aussi des questions éthiques : l’Occident, l’autre, la question de l’ethnocide… Je découvrais une discipline complexe qui imposait que l’on passe par l’ethnographie, puis l’ethnologie avant d’arriver à des choses plus profondes et surtout aux champs incroyablement vastes de l’anthropologie. En fin de compte, je commençais une aventure savante, une sorte de quête à la connaissance qui est bien loin d’être terminée aujourd’hui.
Ce qui m’a plu tout de suite ce sont les cours d’ethnologie du monde moderne, qui me permettaient d’utiliser ma formation rigoureuse d’historien tout en étant dans des préoccupations présentes. Au sortir de 68, l’ambiance intellectuelle était à la contestation et à la critique radicale des disciplines elle-même. Ma génération s’inscrivait naturellement dans ce type de questionnement autour du désir de « vivre ici et maintenant ». Je me souviens, sur le tableau de notre salle à Jussieu, était inscrit à la peinture indélébile : « on n’arrête pas le printemps »... Et je n’ai jamais arrêté le printemps.
Je crois que l’ethnologie faisait et fait toujours partie de cette fête d’été sans fin. Cela a été l’entrée dans une vie trépidante pleine de rencontres, de voyages en Amérique du Sud et du Nord , en Laponie en Bourgogne , etc. Des rencontres autant avec des poètes que des savants – pour moi à l’époque nos professeurs en étaient indubitablement – et de passions intellectuelles sur lesquelles je reviendrai. Autre chose importante, ce département d’ethnologie à Jussieu avait commencé de façon pirate en opposition à l’ethnologie structuraliste de Lévi Strauss, qui était enseigné à l’EHESS et surtout à Nanterre.… À l’époque, on se définissait à travers des appartenances à des écoles. La polémique était possible et même recherchée. On n’était pas dans la censure mais dans une poussée de vie. Moi je m’y suis trouvé très bien. J’y ai rencontré des enseignants comme Robert Jaulin (cf La Paix Blanche, Seuil, 1972), Pierre Bernard, Serge Moscovici (La société contre nature, UGE), Jean Monod (Riche Cannibales, UGE, 1972), Michel Panoff (L’ethnologue et son double, Payot, 1977), Pierre Clastres (La société contre l’état, Seuil, 1972), Jacques Meunier (Le chant du Silbaco, Payot, 1972), Jean Malaurie (Les derniers rois de Thulé, Terre humaine / Plon, 1955), etc. Ceux-ci animaient des « cours pirates », nous donnaient une liberté de parole et de pensée toute nouvelle et bien peu académique parce qu’ils n’étaient pas bloqués dans l’institution, même si le département est devenu officiellement une UFR de l’Université Paris 7 l’année où j’y suis entré. C’était un lieu ouvert où l’on vivait littéralement ensemble. On allait chez nos professeurs, ils venaient chez nous, on partait même parfois sur le terrain ensemble, bref, c’était une véritable aventure intellectuelle communautaire et quelque peu libertaire, enthousiasmante évidemment pour un jeune étudiant. Toujours est-il que je découvrais l’ethnologie à ce moment charnière où se posait la question de l’existence même de l’ethnologie en termes éthiques, où l’occident se mettait en question, revenait sur son histoire, ses manières d’être à l’autre – je pense à la question de l’ethnocide, cette façon insidieuse de détruire la culture de l’autre – et où nous repensions l’anthropologie à partir du monde moderne et de son avenir.
Un des points fort de l’enseignement et des actions que nous menions à partir de l’UFR fut l’écologie ; je dirais plus précisément l’écologie politique que nous inventions ensemble et qui, il faut bien le reconnaître, reste la seule innovation qui ait profondément et pour une longue période je le crains - car il s’agit de l’état de notre planète -, irrigué notre forme de vie actuelle et, petit à petit, toute la culture politique contemporaine. Enfin, rapidement initié à cette ethnologie en rupture, en 1975, je passais ma thèse de IIIe cycle en ethnologie sur les frontières, désormais bien minces, qui séparaient l’histoire de l’ethnologie. En 1987, j’étais élu Maître de conférence dans le département d’ethnologie de l’Université Paris 7 dont j’assurerai la direction à la suite de Robert Jaulin de 1990 à 1996. Durant cette période, je soutenais enfin mon doctorat d’état en 1992, qui me donnait de facto l’habilitation à diriger des Thèses, HDR. Je fondais également avec l’ethnologue-cinéaste Jean Arlaud, le Laboratoire d’Anthropologie Visuelle et sonore du Monde Contemporain. En 2004 je me retrouve dans le département des Sciences Sociales, l’Université de Paris 7 ayant jugée bon de dissoudre l’UF AESR et le LAVSMC estimant que l’ethnologie avait assez vécu en ses murs alors que jamais dans notre société en mutation, les questions anthropologiques ne se sont posées de façon aussi cruciale. Que comprendre ?