 Le 1er juillet 2007 s’est tenu au Parc floral de Vincennes le « Premier salon du tatouage et des arts associés » où se sont rassemblés des centaines d’artistes et de modèles itinérants qui prennent le corps comme support à leur art. Dans n’importe quelle revue « people » d’aujourd’hui apparaissent des vedettes, plutôt des jeunes hommes et des jeunes femmes, tatoués pour la vie : qui une petite fleur à la base du cou, qui un papillon sur une cheville ou un motif Maori épuré sur les biceps, quand ce n’est pas une fresque immense recouvrant tout le corps d’un de ces nouveaux héros du monde moderne que sont nos sportifs, nos comédiens et nos chanteurs.
Le 1er juillet 2007 s’est tenu au Parc floral de Vincennes le « Premier salon du tatouage et des arts associés » où se sont rassemblés des centaines d’artistes et de modèles itinérants qui prennent le corps comme support à leur art. Dans n’importe quelle revue « people » d’aujourd’hui apparaissent des vedettes, plutôt des jeunes hommes et des jeunes femmes, tatoués pour la vie : qui une petite fleur à la base du cou, qui un papillon sur une cheville ou un motif Maori épuré sur les biceps, quand ce n’est pas une fresque immense recouvrant tout le corps d’un de ces nouveaux héros du monde moderne que sont nos sportifs, nos comédiens et nos chanteurs. On ne change pourtant pas de peau comme de chemise et être tatoué, comme tatouer, ce n’est pas, a priori, chose « normale » pour les mammifères non spécialisés que nous sommes. Outre le désir dans nos sociétés occidentales contemporaines d’enfiler une nouvelle peau, le tatouage implique qu’il y ait quelque part un modeleur, ou plusieurs, qui prennent les mesures de la personne, qui, elle-même, se prépare à enfiler ce tissu douloureusement relié à travers sa peau à toute la société qui l’entoure (même si elle ne le sait plus consciemment). Cet habillage incarné, indéniable accessoire contemporain de la mise en scène de soi, art véhiculaire de son groupe ou de sa société se fait rarement seul ni uniquement pour soi .
Regarder « la peau de l’homme », surtout décorée, c’est regarder notre peau que nous n’avons de cesse de sauver et d’embellir. C’est donc à travers des travaux d’ethnographes qu’il faut aller chercher les descriptions par le menu de ces écritures sanglantes qui, de la fraîche peau où elles furent tracées, se retrouvent aujourd’hui parcheminées et présentées dans nos musées, par petits ou grands morceaux ou, moins douloureusement, à travers des dessins et des photographies. En faisant appel aux descriptifs passés et présents, ce qui importe est surtout de revenir sur le regard que nous portons sur ces œuvres ; œuvres qui ne sont plus ou pas des objets de matière minérale ou végétale mais bien des objets humains directement empruntés au corps de l’homme.
Regarder « la peau de l’homme », surtout décorée, c’est regarder notre peau que nous n’avons de cesse de sauver et d’embellir. C’est donc à travers des travaux d’ethnographes qu’il faut aller chercher les descriptions par le menu de ces écritures sanglantes qui, de la fraîche peau où elles furent tracées, se retrouvent aujourd’hui parcheminées et présentées dans nos musées, par petits ou grands morceaux ou, moins douloureusement, à travers des dessins et des photographies. En faisant appel aux descriptifs passés et présents, ce qui importe est surtout de revenir sur le regard que nous portons sur ces œuvres ; œuvres qui ne sont plus ou pas des objets de matière minérale ou végétale mais bien des objets humains directement empruntés au corps de l’homme.
Il ne fait aucun doute que les tatouages sont ou bien deviennent des rites intégrateurs en même temps que des amulettes permanentes au pouvoir magique évident pour tous ceux qui les portent. Le tatouage d’immunisation qui, dans certaines « professions » ( pirates , voleurs, etc), est de grande vantardise obtient sa grande puissance par la peau de l’homme qui le porte, la souffrance qu’il a subi et l’art de l’exécutant, bref toutes conditions réunies pour atteindre à une perfection surnaturelle, sans oublier évidemment ceux qui le lisent en en connaissant les codes et qui doivent être pris d’effroi devant une telle arme.
On sait par l’histoire et l’anthropologie que ces amulettes permanentes connurent dans la plupart des sociétés où elles ont été dé
 crites une régression, voire une disparition. Ceci est dû à la fois à l’emprunt et à l’influence des autres styles de tatouage ainsi qu’à leur emprunt par d’autres sociétés comme la nôtre, c'est-à-dire à une dévaluation. On sait également que la régression d’une coutume dans un groupe social est souvent contrebalancée par l’acquisition de nouveaux signes empruntés aux sociétés voisines ; emprunts liés autant à une recherche d’actualisation qu’à une enculturation involontaire, qui conduit à très brève échéance à une acculturation et à long terme à un ethnocide. Dans les sociétés décrites types océaniennes, asiatiques ou amazoniennes, à l’archaïsme des tatouages anciens ont souvent fait place des tatouages plus modernes.
crites une régression, voire une disparition. Ceci est dû à la fois à l’emprunt et à l’influence des autres styles de tatouage ainsi qu’à leur emprunt par d’autres sociétés comme la nôtre, c'est-à-dire à une dévaluation. On sait également que la régression d’une coutume dans un groupe social est souvent contrebalancée par l’acquisition de nouveaux signes empruntés aux sociétés voisines ; emprunts liés autant à une recherche d’actualisation qu’à une enculturation involontaire, qui conduit à très brève échéance à une acculturation et à long terme à un ethnocide. Dans les sociétés décrites types océaniennes, asiatiques ou amazoniennes, à l’archaïsme des tatouages anciens ont souvent fait place des tatouages plus modernes.Du point de vue anthropologique c’est beaucoup moins une inconsciente remise en honneur possible d’une pratique oubliée que l’emprunt conscient d’une coutume, souvent inconnue ou mal connue des générations qui l’adoptent et qui revêt d’autant plus d’importance que son développement coïncide avec la nette régression d’autres systèmes de transformation ou de mutilation corporelles (agrandissement du lobule de l’oreille, mutilation dentaire), toutes ces coquetteries qui sont tombées en désuétude parce qu’elles ne correspondaient plus à aucun idéal magique ou social vivant.
On aurait pu dire, il y a encore une trentaine d’années, que la mentalité populaire associe le prestige viril et le courage déployé en présence du tatoueur, et que le tatouage est inséparable de la majesté masculine. Mais cette idée de « dignité virile » n’a plus cours aujourd’hui que pour quelques mâles marginalisés ou en cours de l’être… Se faire tatouer n’est plus réservé, en effet, aux seuls hommes, les femmes s’y prêtant tout autant et peut-être même plus.
Curieuse histoire en vérité que celle des tatouages passés du « sauvage naturel » au jeune « civilisé urbain » contemporain ; tatouage dont on ne sait plus très bien s’ils est décalcomanie estival et branché, intention amoureuse définitive ou œuvre d’art indélébile qu’on cache ou fait réapparaître au gré des modes et des usages.
Tatouage et piercing sont sortis de la marginalité occidentale pour devenir des accessoires da la mise en scène de soi. On voit refleurir des artistes itinérants qui prennent le corps comme support et des corps se faire l’expression cachée-montrée d’un art véhiculaire, venant confirmer ce que les anthropologues ont constaté depuis les années 1970, que ce qui caractérise le monde moderne est son apparente et ostentatoire archaïsation. Le corps est chez nous devenu il y a quelque temps prothèse d’un moi en quête d’une incarnation pour sursignifier sa présence au monde, pour qu’on essaye à nouveau d’adhérer à soi. La question reste et restera de savoir ce qui nous fait courir après ce décor-homme ?



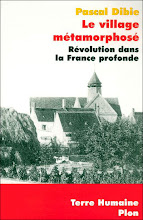
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire