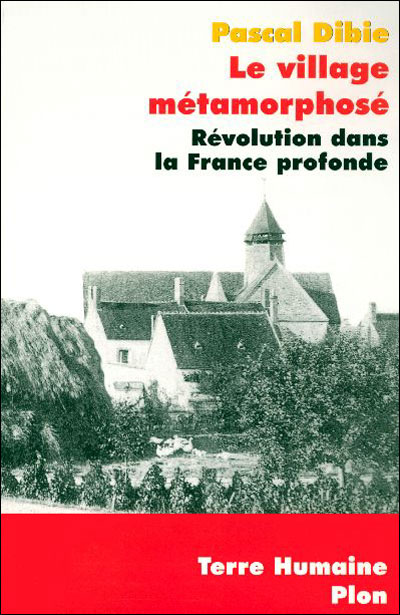Le CNRS prochainement va republier en poche l’ouvrage de Francis Huxley « Aimables sauvages » traduit il y a plus de soixante ans pour la collection Terre Humaine par Monique Levi-Strauss. Il paraîtra sous un titre plus proche du titre original : « Affables Sauvages ».
Avec Francis Huxley chez les Urubu, qui s'appellent eux-mêmes Kaapor, « les habitants de la forêt » en langue Tupi, on est loin du diffusionnisme anglo-saxon, plus proche peut-être du fonctionnalisme de Malinowski. Un fonctionnalisme revisité avec bien sûr la prise en compte des « impondérables de la vie authentique » pour reprendre le Maître, ainsi que des comportements et des attitudes des Indiens qu’il décrit. Un fonctionnalisme inspiré par Edmond Leach, avec en moins l’illusion que toute société primitive est à lire comme un ensemble harmonieusement équilibré ainsi que cette théorie l'induisait un peu naïvement et que l'anthropologue doit rester conscient des lacunes mêmes de son travail, liées d'une part à sa vision, d'autre part aux conditions dans lesquelles il effectue son terrain.
Huxley avec ses trop « affables sauvages » -il manie aisément la litote, le paradoxe et l'humour anglais- nous éloigne définitivement du mythe du « bon sauvage » d’un Diderot, d’un Bernardin de Saint-Pierre ou d’un Rousseau. La très assumée «observation participante» de l’auteur qui s’affranchit à sa manière des références à notre culture occidentale pour mieux comprendre les mentalités et les valeurs de ceux avec qui il partage un temps sa vie, ce refus de l’ethnocentrisme alors encore largement en vigueur dans ces années 1960, lui permettent de tenter une investigation globale de l’univers des Urubu. Sa conception de l'analyse fonctionnelle est conçue comme une vérification empirique incessante et multidimensionnelle de ses amis Indiens dont il ne tait ni l'étrangeté ni la cruauté (par rapport à l'idée que nous nous en faisons) ni même l'état d' « anarchie ordonnée », pour reprendre Evans Pritchard, qui régirait leur organisation sociale, rappelant que «Les Urubu dont la vie est si souvent troublée par les querelles, les guerres et les irruptions du surnaturel, aiment à rêver d'un ordre utopique.». Huxley ne s'embarrasse pas des scories d'un scientisme qui souvent fait écran à la pure observation; il nous fait comprendre que toute culture, au sens plein du terme, est dynamique et que chez les Urubu le groupe n’existe que dans son rapport d’opposition aux autres groupes, voisins directs, redoutés Guajaja ou mythiques tribus cannibales enfouies dans la forêt et même disparues depuis longtemps. Il ne méconnaît pas les éléments internes (c'est à dire non fonctionnels) dont toute culture est porteuse, ce qui explique qu'il ne néglige pas de rapporter les très nombreux conflits dans la vie de ces sociétés en marginalisation d’elles-mêmes.
Bien moins dogmatique que Bronislaw Malinowski, il ne dit pas non plus que tout système culturel serait une réponse à quelques besoins fondamentaux. Ceci explique en partie qu'il envisage le système de parenté de ses compagnons un peu à la manière d’un Radcliffe-Brown, s’appuyant sur une réalité empirique toujours à relire. Contrairement à Lévi-Strauss qui a voulu réduire l’extrême diversité des règles de mariage et de parenté à quelques types d’échanges de femmes, y voyant un système de relations d’opposition et de complémentarités, Huxley montre les attitudes individuelles et familiales comme ne pouvant se comprendre que les unes par rapport aux autres, en fonction des principes structuraux propres à la culture qui les organise. Ces principes permettent d’expliquer qu’à l’attitude du respect filial dont font preuve les enfants dans de nombreuses sociétés s’oppose une attitude de familiarité, voire de plaisanterie, à l’égard des grands-parents et de toute la génération précédant celle des parents et que le tabou de l'inceste, apparemment plus souvent franchi qu'on voudrait le croire, n'est dans ces sociétés puni d'aucun châtiment humain, «le châtiment s'il existe, étant plutôt d'ordre surnaturel» chez les Urubu, décidément peu conformes aux règles orthodoxes énoncées en anthropologie.
Suruquer et faire la guerre pour capturer des femmes semble être une des grandes préoccupations de ces Indiens au point qu'on a du mal à saisir si c'est le système lui-même, les femmes ou les hommes avec leurs obsessions qui produisent ces étranges et fréquents rapports humains. Désir, don, contre-don, forçage et surucage, bref «manger l'autre» au sens littéral et mythique s'impose de telle façon que l’auteur, fasciné par un monde où «les valeurs morales n'y ayant pas de place», ne peut que nous entraîner et nous égarer dans le monde de la forêt si éloigné de notre vision du monde. Cette «grande petite histoire» de l'humanité, soit dit en passant, finit par encombrer un peu le livre et peut-être l'auteur qui s'en défend en redisant l'égale importance dans cette société de la mythologie, du régime alimentaire, de la sexualité, mais aussi la respiration, les sécrétions internes, la circulation, la digestion, bref l'ensemble des activités humaines qui font sens au regard de l'univers dans lequel elles se déploient. Pour les sceptiques ou les envieux, Huxley rappelle que «les Indiens pensent à l'amour (et aux fonctions physiologiques qui s'y rapportent) non seulement comme à un divertissement agréable mais encore comme à une force de nature spirituelle et contagieuse qui, si on en fait mauvais usage, peut avoir les mêmes effets qu'un poison, » ajoutant que « la tradition se charge de remanier tous les instincts».
Son ethnologie délibérément narrative participe à engager l’ethnologie dans ses voies les plus actuelles, tout comme sa subjectivité assumée laisse filtrer tout ce qu'il y a de plus humain chez ces Indiens. On comprendra aussi que Francis Huxley ne néglige pas la langue vernaculaire. La large utilisation qu'il en fait tout au long de son récit (ce qui nécessite la présence d'un glossaire en fin d'ouvrage), nous rappelle, à la suite de Sapir et de Whorf que pour comprendre une société en profondeur il faut toujours se fier aux mots et aux expressions décrivant l'environnement physique qui, dans une large part, suggère une organisation sémantique et mentale de la société qui y est inscrite.
De même il ne pouvait ignorer les processus d’acculturation. Cette violence absolue qui se traduit en termes de décivilisation, voir d'ethnocide souvent dramatiquement doublé hélas de génocides involontaires. L’histoire de Ces Indiens clochardisés, comme la fin paradigmatique de cette femme Urubu atteinte de la rougeole, qu'on retrouve morte sur le bord d'un chemin, abandonnée de tous, sonnent ici comme un épilogue à la question indienne. Cela nous rappelle aussi que le récit de Francis Huxley qui voyagea avec Darcy Ribeiro dont on ne lira «les carnets indiens» qui concernent ces mêmes Urubu que quarante plus tard dans cette collection, contribua, après la publication du très fameux «Tristes Tropiques» de Claude Lévi-Strauss, à réenchanter un peu les tropiques. Le monde amazonien aura d'ailleurs toute sa place dans cette famille rassemblée en Terre Humaine si l'on pense à la pathétique « Yanoama » d'Ettore Biocca , la philosophique «Chronique des Indiens Guayaki » de Pierre Clastres , les très engagées « Veines ouvertes de l'Amérique latine » d'Eduardo Galeano et la publication prochaine des profonds et spirituels dires de Davi Kopenawa, recueillis par Bruce Albert qui met en garde l’Occident et ses folies et annonce pour bientôt « La chute du ciel ».
skip to main |
skip to sidebar
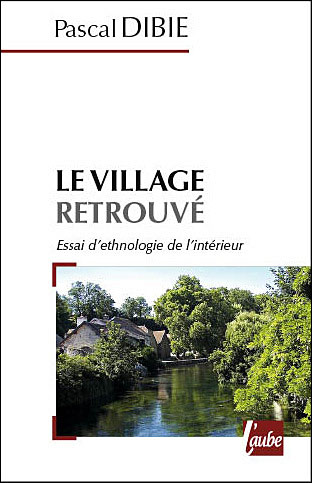
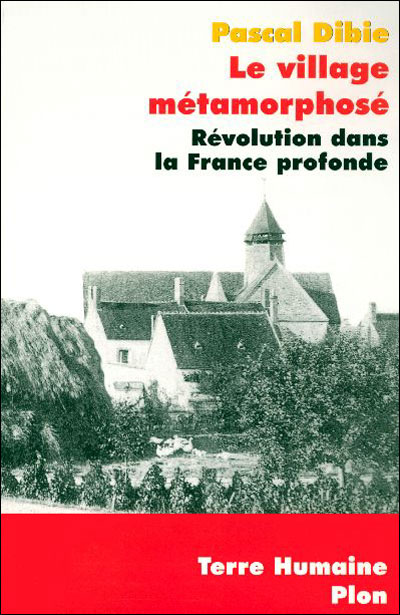
Ethnologie, moeurs, rituels ...
Chroniques
- A propos de l'auteur (2)
- Humeurs (20)
- Parmi ses publications... (2)
Publication - janvier 2008
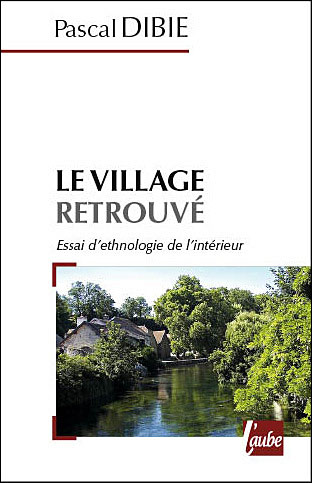
Publication - mars 2006